
En 1803, Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis pour financer ses guerres européennes. Cette transaction couvre en tout ou en partie 14 états américains actuels, ouvrant ainsi la porte à un vaste territoire pour le jeune pays. L’année suivante, Lewis et Clark sont mandatés par le président Jefferson pour explorer le territoire et trouver un passage vers l’océan Pacifique. Les États-Unis commémorent l’évènement depuis l’an 2000 en frappant une pièce de monnaie en or sur laquelle nous apercevons une Amérindienne, Sacagawea, et son fils sur son dos.[1] L’histoire américaine retient que Sacagawea fut la guide des explorateurs vers les Rocheuses, ouvrant les routes continentales du pays pour son expansion vers l’Ouest. Toutefois, l’histoire américaine ne souligne pas le nom du fils sur son dos ; Jean-Baptiste Charbonneau, fils Toussaint Charbonneau, un coureur des bois installé dans la région.
En arrivant à Saint-Louis, Lewis et Clark trouvent que l’anglais est une langue peu utile en cet endroit.[2] Vivant dans la région parmi les Mandanes, Toussaint Charbonneau est engagé comme guide de l’expédition vers les Rocheuses. Sa femme Sacagawea, une Shoshone l’accompagne avec leur nouveau-né. L’expédition recrute également d’autres francophones habitant la région. Sacagawea compte sur l’expédition pour retourner auprès des siens vivant plus à l’ouest. Par ailleurs, l’expédition compte sur les Shoshones pour les guider au-delà de leur territoire. L’un des défis de l’expédition consiste à retrouver son chemin dans un monde défiguré par les épidémies, où même Sacagawea en perd ses repères : « Les épidémies frappant nation après nation, tout au long du chemin ils ont aperçu bon notre de campements déserts et, de-ci de-là, errant seul dans le lointain, un cheval débridé. »[3]
Lewis et Clark minimiseront toujours le rôle de Charbonneau et des siens dans le succès de l’expédition. Toutefois, l’expédition a croisé celle de François Antoine Larocque, engagé par la Compagnie du Nord-Ouest de Montréal, qui poursuit un but similaire, à savoir la recherche de nouvelles routes de commerce. Le journal de Larocque est la seule source écrite alternative sur l’expédition de Lewis et Clark. Grâce à lui, nous savons d’une autre source que Lewis et Clark partageaient leurs tipis nuit après nuit avec Toussaint, Sacagawea et leur fils Jean-Baptiste. « Curieusement, nos capitaines américains mentionnent à peine cette rencontre avec l’expédition canadienne de ‘Mr. La Rock’. Enivrés de leur propre mythe, ils préfèrent croire et laisser croire que, vraiment, aucun homme blanc n’a jamais posé le pied sur ce territoire…dont les peuples ont déjà été nommés par les Canadiens français. »[4] De cette façon, le rôle de Toussaint Charbonneau et des autres Canadiens d’origine dans le succès de cette expédition sera toujours minimisé.
Expédition de Lewis et Clark

Les deux grandes expéditions d’exploration ayant pour but la découverte d’un passage dans les Rocheuses sont financées par des Anglo-américains de la Côte-Est; par contre, elles sont conduites par des Canadiens d’origine évoluant déjà dans la région. Depuis leur arrivée, l’approche des Canadiens d’origine avec les autochtones était plus fructueuse que celle des Anglo-américains : Lewis et Clark apportent des fusils pour se prémunir des attaques des Amérindiens de la région, tandis qu’un Pierre Cruset se déplace avec son violon pour amadouer les Amérindiens.[5]
L’épopée des explorateurs francophones, des trappeurs, des Amérindiens nomades suivant de spectaculaires troupeaux de bisons tire à sa fin. L’arrivée de Lewis et Clark annonce la marche du progrès industriel vers sa conquête de l’Ouest. Les routes des coureurs des bois deviendront pour les colons des États-Unis une porte vers l’Ouest, s’ouvrant sur le paradis annoncé par le mythe de la Destinée manifeste berçant le pays. Dans ce monde sauvage, les colons anglo-américains arrivent avec le concept de la liberté développé sur la Côte-Est ; « Aucune loi ne protège les bisons, aucune loi ne protège vraiment les Indiens, et le mot « extermination » est sur toutes les lèvres. »[6] La construction du chemin de fer transcontinental sera prétexte à l’extermination des bisons et à l’anéantissement des cultures autochtones qui en dépendaient. Avant l’extermination des bisons, les grandes chasses réussissaient des centaines de familles, le bison était un élément fédérateur des cultures amérindiennes et métis.
Bien avant la construction du chemin de fer, l’épopée de la traite de la fourrure poursuit sa fuite en avant vers l’Ouest. Dans la grande aventure de la Conquête de l’Ouest se déroulant entre 1800 et 1850, parmi les « ouvreurs de pistes, canoteurs, convoyeurs, éclaireurs, trappeurs, traiteurs, guides, interprètes, chasseurs, entrepreneurs du Mississippi au Pacifique, à travers plaines et montagnes, quatre travailleurs des fourrures sur cinq étaient alors des Canadiens français. »[7] La prise de contrôle de l’Ouest du continent ne sera pas facile pour les Anglo-américains : Clark, après son expédition, tente de se lancer dans la traite de fourrures, mais échoue en raison d’un féroce compétiteur de la région, Antoine Robidoux. Toutefois, le temps des marchands comme Robidoux et ses employés respectés pour leur intégrité par les Utes, Shoshones et les Comanches tire à sa fin : « maintenant que les Américains envahissent leurs terres ancestrales la colère des Indiens est à son comble et l’anarchie s’installe. »[8] Initialement, l’ouverture pacifique de l’Ouest grâce au commerce de la fourrure ne fut l’affaire que des Canadiens d’origine. Après la saga de la traite de fourrures, ils demeurent les guides de diverses grandes expéditions : en 1843, Étienne Provost sera guide pour le célèbre ornithologue et peintre naturaliste James Audubon ou pour des aristocrates européens en mal de sensations fortes.
Sur les chemins de l’Amérique du Nord conduisant vers côte Pacifique, le français demeure jusqu’en 1840 la « langue des fourrures » dans l’Ouest.[9] La langue française demeure la langue du commerce au cœur du continent jusqu’à milieu du XIXe siècle. Pour les gens mécontents de la situation au Bas-Canada, l’Ouest est le lieu de tous les possibles. « À l’ouest du Mississippi, le français et l’espagnol étaient encore les langues d’usage, avec le sioux dans toutes ses variantes, et l’algonquien, dont on sait qu’il fut pendant longtemps la langue des voyages et du commerce, dans la grande histoire de l’Amérique. »[10] Au milieu du XIXe siècle, à l’aube de la ruée vers l’Ouest des colons anglophones, ce monde, dit sauvage, regorge de cultures en mouvance portant différents courants du développement humain s’exprimant dans une diversité de langues, dont le français.
Depuis le début de la colonisation française, des voyageurs s’enfoncent de plus en plus profondément dans le continent pour faire la traite de fourrures avec les autochtones avides des nouvelles technologies provenant d’Europe. Une première vague de personnes quitte le Québec suite à la Conquête, principalement des personnes métissées. Ainsi, la quête de liberté se poursuit : « À partir de 1770, des milliers de Canadiens français ont quitté́ la vallée du Saint-Laurent pour aller aux aventures du Grand Ouest américain et canadien. »[11] En 1812, un voyageur lettré dans une expédition vers l’ouest note la présence d’un territoire canadien-français le long du Missouri entre Saint-Louis et Kansas City.[12] Cette colonisation le long du Missouri démontre bien l’intégration de la culture des Canadiens d’origine dans un monde encore dominé par les autochtones. Par cette relation privilégiée avec les Amérindiens, les Canadiens d’origine ont connecté les routes du continent au reste du monde.
Dans la mythologie américaine, l’expédition de Lewis et Clark de 1804 a ouvert l’Ouest ; Toussaint Charbonneau et les Canadiens d’origine n’ont pas leur place dans ce mythe de la découverte d’une route à travers les Rocheuses. Au même titre que Pocahontas, dans la commémoration de cette saga devant être bien anglo-américaine, l’histoire officielle ne retient que Sacagawea, la conjointe de Toussaint Charbonneau, tout en taisant le nom de leur nouveau-né.
Cette mémoire déficiente illustre l’oblitération de l’histoire des francophones dans l’ouverture de l’Amérique du Nord sur le monde. « Beaucoup d’hommes de la piste, Canadiens des montagnes, vécurent aux États-Unis sans jamais apprendre l’anglais, une langue qui n’était pas d’une grande utilité à l’ouest du Mississippi avant 1840. »[13] Le déclin de la francophonie à travers l’Amérique du Nord entraîne l’assimilation des nombreux descendants des Canadiens d’origine à la culture anglo-américaine. À l’inverse, la culture américaine a intégré un peu de l’esprit des Canadiens d’origine qui ont su ouvrir le continent aux Européens en poursuivant leur rêve de liberté. Cet effacement du fait français en Amérique du Nord laisse croire que les Québécois d’aujourd’hui sont un peuple fermé, frileux, isolé. La pensée dominante anglo-américaine fait porter aux Québécois un chapeau de vilains pure laine xénophobes ; pourtant, bien des légendes de bûcherons, de cowboy et plusieurs symboles prennent leur source dans la saga de ces Canadiens d’origine partis à la poursuite de la liberté.
L’expansion de la présence francophone en Amérique du Nord fut étroitement liée au commerce de la fourrure. Son maintien devient impossible suite à la disparition des milieux de vie sauvage. Le nouveau modèle économique en provenance de l’Est modifie l’environnement pour satisfaire des objectifs de croissance d’un capital financier. La société de consommation remplace le mode de vie des gens libres du continent vivant de leur terre. L’idéal de liberté poursuivi par les Canadiens d’origine dans l’Ouest disparaît de la mémoire collective, tout comme la consommation de la banique : « Les Amérindiens et les coureurs des bois mangent de la banique, une galette faite de farine de maïs, de graisse d’ours et de sucre d’érable, pour leur donner de l’énergie lors de leurs longs déplacements.»[14] L’ouverture de l’Ouest intensifie la disparition du riche environnement de l’Amérique du Nord, ainsi s’efface de nos mémoires la banique, ce lien profond entre la traite de la fourrure et l’exploitation de l’eau d’érable.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Cliquer ici pour soutenir l’expression d’un Québec Pur Sirop →
[1] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[2] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p316
[3] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p209
[4] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p212
[5] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[6] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p222
[7] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p312
[8] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p336
[9] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p143
[10] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[11] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[12] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p317
[13] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012
[14] https://ppaq.ca/fr/sirop-erable/origines/ en ligne 2 novembre 2020
Pendant l’hiver 1810, lorsque l’American Fur Company décide de créer une filiale, la Pacific Fur Company pour conquérir le marché du Nord-Ouest de l’Amérique du Nord, John Jacob Astor envoie un agent à Montréal pour tenter de former une alliance avec la Compagnie du Nord-Ouest pour concurrencer la Compagnie de la Baie d’Hudson. L’invitation est déclinée, mais « les Écossais, bons joueurs, lui conseillent tout de même d’avoir recours aux services des coureurs des bois canadiens, dont les compétences sur le terrain s’avèrent indispensables à la réussite de voyages aussi extrêmes. »[1] Gabriel Franchère est recruté pour cette expédition qui se déroule en deux volets, l’un terrestre et l’autre maritime. Sur le Tonquin, Franchère prend part à l’expédition maritime partant de New York en 1810. Elle compte rejoindre le fleuve Colombia par l’océan en contournant la Terre de Feu en Amérique du Sud, et en passant par Hawaï pour établir des relations commerciales. L’époque est propice à l’émergence d’un commerce mondial aux mains de grandes entreprises possédant des comptoirs maritimes à travers le monde. Situé au centre de l’Océan Pacifique, cet archipel a été rendu mythique par le célèbre explorateur James Cook qui y trouva la mort 32 ans auparavant. Hawaï devient rapidement un endroit stratégique pour le transit commercial avec la Chine et l’Alaska qui, à l’époque, était un territoire russe. À partir du commerce de la fourrure, Astor développe des échanges fructueux avec la Chine, touchant principalement le thé, la soie et l’opium. Grâce à son réseau commercial, il devient l’homme le plus riche des États-Unis au début du XIXe siècle.
Le navire Tonquin demeure célèbre pour le massacre de ses hommes par les Nootkas de l’île de Vancouver en 1811. Son capitaine avait pour mission d’explorer la côte Pacifique vers le Nord pour établir des contacts, après avoir trouvé l’embouchure du fleuve Colombia. Le capitaine avait déposé à cet endroit l’équipe de McDougall, dont Franchère est l’adjoint, pour établir un poste de traite. L’arrogance du capitaine et son manque de diplomatie, démontrés par de nombreux témoignages, semblent l’avoir conduit à sa perte. Franchère, plus diplomate, devient responsable pour laPacific Fur Compagny du nouveau poste de traite Astoria à l’embouchure du fleuve Colombia. Il revient sur la Côte-Est quatre ans plus tard par la voie terrestre. Tout au long de ce périple, il tient un journal qui sera publié et dont on a écrit : « Au fil du journal de Franchère, il est passionnant de voir surgir ces personnages d’hommes libres, d’ensauvagées, d’ermites, tous ces Canadiens français et Métis dispersés à travers le pays qui représente mille facettes d’une histoire souterraine, ignorée. »[2] Franchère fut un des rares témoins francophones de l’apogée de la traite des fourrures à avoir publié ses mémoires.
Le fameux roman Astoria de Washington Irving, livre mythique aux États-Unis racontant l’épopée de la traite de fourrure, s’inspire directement des écrits de Franchère : « Irving se montre remarquablement méprisant envers les voyageurs canadiens-français, ce qui ternira leur réputation dans la mémoire américaine pour des générations de lecteurs. Franchère en est outré. »[3] Lorsque Franchère publie la version anglaise de son journal de voyage des expéditions de 1812, 1813, 1814 et 1815, il ajoute des renseignements pour rectifier des faits et corriger les mauvaises impressions laissées par le roman de Irving. Les mémoires de son journal, traduites en anglais, paraîssent sous de nombreuses éditions aux États-Unis, dont The First American Settlement on the Pacific (Le premier établissement américain sur le Pacifique ou La première colonie américaine sur le Pacifique). Ne se considérant pas comme un scientifique, Franchère avait hésité avant de publier les humbles témoignages de ses expéditions, pourtant : « il fera autorité au Sénat américain lors des disputes entourant les frontières de l’Oregon. »[4] La confiance du Sénat des États-Unis envers le témoignage de Franchère devient plus facile à comprendre en apprenant que le lieu mythique de la fondation de l’Oregon se nomme The French Prairies.
L’un des plus hauts sommets de l’Oregon est connu comme étant le mont McLoughlin en l’honneur de John McLoughlin, un représentant de commerce de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il est né à Rivière-du-Loup le 19 octobre 1784, sous le nom de Jean-Baptiste McLoughlin. Irlandais de seconde génération, il représente cette mixité du terroir québécois : sa mère est descendante de Malcom Fraser, un soldat écossais des Fraser Hightlanders rester après la Conquête. Ses origines font de lui un homme à cheval sur deux mondes, l’un franco-catholique et l’autre anglo-protestant. Il fait des études de médecine à Montréal. Selon la rumeur suite à une rixe avec un officier britannique ivre, son oncle Alexendre Fraser lui trouve un emploi de médecin auprès de la Compagnie du Nord-Ouest pour l’éloigner de ses problèmes juridiques.
Cette décision semble convenir à cet homme au tempérament fougueux que la vie routinière n’attire pas. En 1806, il se retrouve au fort Kaministiquia, renommé Fort William par les Écossais, maintenant Thunder Bay. Ce poste de traite est le grand centre opérationnel de la Compagnie du Nord-Ouest, en féroce compétition avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. Sous contrôle écossais, la Compagnie du Nord-Ouest a son siège social à Montréal, tandis que l’entreprise fondée par Radisson passée sous contrôle anglais a toujours son siège social à Londres.
Dans des contrées sauvages, sans foi ni loi, les conflits entre les deux entreprises finissent par dégénérer. En juin 1816, un accrochage entre les hommes des deux compagnies se solde par la mort de 21 personnes de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Cet incident, dont Jean-Baptiste McLoughlin fut l’un des premiers à constater les conséquences tragiques, pousse les deux entreprises à entreprendre des négociations en vue d’une fusion. En 1820, McLoughlin se retrouve à Londres à titre de représentant de la Compagnie du Nord-Ouest pour négocier sa fusion avec la Compagnie de la Baie d’Hudson ; une négociation historique entre les deux plus grandes entreprises de fourrures d’Amérique du Nord. Il profite de son voyage sur le vieux continent pour aller rendre visite à son frère David à Paris, « qui a été décoré de la Légion d’honneur par Napoléon Bonaparte, et qui deviendra dix ans plus tard le médecin personnel de Louis-Philippe 1er, roi des Français. »[5] Les McLoughlin, bien que venant d’un endroit éloigné des grands centres comme Rivière-du-Loup, démontrent l’esprit d’aventure des gens du Québec pour se joindre à la marche du monde.
La fusion des entreprises est réalisée en 1821; la nouvelle entreprise conserve le nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson en raison de sa notoriété historique. En 1824, Simpson, le nouveau gouverneur pour le département du Nord de la Compagnie de la Baie d’Hudson confie à McLoughlin la réorganisation de la traite dans le district de Colombia. Son chef-lieu, le poste Astoria, affiche des résultats insatisfaisants : ouvert par l’American Fur Company, passé aux mains de la Compagnie du Nord-Ouest lors de la guerre de 1812, le poste de traite fut intégré à la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1821. Arrivé sur place, McLoughlin est accueilli par les employés de l’endroit « qui sont restés ici pour faire la traite : les Pariseau, Gervais, Laframboise, Lussier, Labonté… »[6] Bien que l’endroit soit magnifique, sa localisation près de l’océan Pacifique l’expose à des attaques de pirates, en plus d’être peu propice à l’agriculture. Il est décidé, en accord avec le gouverneur, de relocaliser le poste. Le nouveau poste porte le nom de Fort Vancouver, à ne pas confondre avec la ville du même nom. Son emplacement est situé au voisinage de l’actuelle ville de Portland en Oregon.
Le district de traite Colombia est immense : il part « de la vallée de Sacramento en Californie jusqu’à Stikine aux frontières de l’Alaska, et du Pacifique jusqu’au-delà des Rocheuses. »[7] Cet endroit aux confins de l’Amérique du Nord demeure l’un des rares territoires encore inexploités pour ses fourrures. Il suscite la convoitise des Russes au nord, des Mexicains au sud et des Anglo-Américains arrivant par Saint-Louis. Vers 1835, le nouveau poste comprend une quarantaine de bâtiments et accommode huit cents personnes vivant avec leur famille dans une cinquantaine de cabanes. Outre les bâtiments de service servant directement à la traite, plusieurs autres servent au soutien de la traite comme un hôpital, un atelier de charpentiers, une forge, un moulin, une grange. Une ferme modèle est mise en place où les récoltes abondantes de céréales et de légumes contribuent à la vitalité du poste. Des vergers et des vignes fournissent en abondance poires, pommes, raisins et autres fruits. Une ferme d’élevage comprenant 2 000 têtes de bétail, porcs, bœuf et moutons, ainsi qu’une centaine de chevaux démontre la prodigieuse croissance de l’endroit. Dans les années fastes, Jean-Baptiste McLoughlin dirige 80 postes de traite avec des centaines d’employés, tout en supervisant les navettes de quatre navires océaniques assurant les échanges commerciaux entre l’Oregon et la Chine en passant parfois par Hawaï, ainsi qu’avec Londres en passant par le Cap Horn. Pendant 20 ans, sous la gouverne de McLoughlin, le poste sera l’Eldorado de la Compagnie de la Baie d’Hudson.[8]
Jean-Baptiste McLoughlin jouit d’une grande liberté dans ce vaste territoire : il est l’autorité supérieure offrant la modernité à cette région sauvage. Comme un chef d’État, il envoie ses hommes aux quatre coins du territoire et il reçoit tous les gens de passage à Fort Vancouver, peu importe leur statut : « S’assoient ainsi à sa table des personnalités amérindiennes de différentes nations, ce qui distingue radicalement des dirigeants de la Compagnie de la Baie d’Hudson – du gouverneur Simpson, notamment, qui ne cache pas ses penchants racistes. »[9] Pourtant, la grande diversité d’origine des personnes présentes à cet endroit fait la richesse de Fort Vancouver en favorisant l’échange de produits provenant de divers horizons. À l’instar de bien d’autres Canadiens d’origine, Jean-Baptiste McLoughlin, marié à une Amérindienne, est fier de présenter ses enfants métis. En plus de la culture francophone d’Amérique qui donne le ton des échanges, nous retrouvons à cet endroit des Iroquois francophones de Montréal, des Kanakas d’Hawaï sans oublier des autochtones des nombreuses nations environnantes ; Têtes-Plates, Nez-Percés, Sanpoils, Cœurs-d’Arlène, Nootkas, Cayuses, Clatsops, Nehalems, Chinooks, Salishs, Tillamooks et Kalapuyas.[10] Les quelques Irlandais et Écossais présents doivent connaître un minimum de français pour vivre dans ce milieu embrassant la diversité sur la côte Pacifique de l’Oregon.
À l’occasion du commerce de la fourrure, à la marge de la civilisation anglo-américaine qui s’impose à partir de l’Est du continent, une nouvelle langue se développe dans ce monde ouvert à tous les possibles. Le « jargon de chinook » est un dialecte incluant des mots chinook, nootka, français et anglais. « De langue commerciale, cette lingua franca va s’étendre à un usage courant, du centre de la Colombie-Britannique au nord de la Californie ; parlée par cent mille personnes, on la retrouvera même jusqu’au début du XXe siècle dans certaines institutions publiques, à la cour comme à l’école. »[11] Dans ce monde nouveau unissant le savoir et les connaissances de divers horizons, nous voyons naître la langue d’un peuple nouveau, comme le rêvait déjà Champlain. Dans la fuite vers l’Ouest, le rêve de liberté des coureurs des bois a inspiré un certain rêve californien avant d’être récupéré par le rouleau de la colonisation à l’anglaise.
L’émergence d’un nouveau peuple est contrecarrée par les objectifs profonds de la colonisation anglaise. À l’image de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le gouverneur Simpson s’oppose au mariage entre les Blancs et les autochtones, bien qu’« avant d’épouser une cousine anglaise, ce dernier a entretenu, comme la plupart des traiteurs, de nombreuses relations avec des Indiennes et des Métisses. »[12] Plusieurs Canadiens d’origine ayant trouvé l’Amour dans les riches terres de l’Oregon souhaitent s’y établir en cultivant leur petit lopin de terre. La Compagnie décourage les mariages mixtes en incluant dans le contrat d’engagement du coureur des bois une obligation à signer son désengagement au même endroit qu’il a signé son engagement, et ceci pour s’assurer qu’il quitte le territoire de traite. Comme la plupart des gens s’engagent à Montréal, ils doivent y retourner pour se libérer de leur contrat. Dans un geste de défi, Louis Labonté fait le trajet aller-retour entre l’Oregon et Montréal pour signer sa décharge. Il embarque avec une brigade de voyageurs en route pour la Baie James. Rendu à la colonie de la Rivière-Rouge, il bifurque vers la tête des Grands Lacs pour prendre le chemin qui marche vers Montréal. Pour le retour, il s’embarque à Lachine avec une brigade vers la Rivière-Rouge, de là vers Le Pas au nord du Manitoba, puis vers Fort Vancouver en Oregon. En canot, le trajet lui prit presque qu’un an de sa vie, quatre mois à l’aller et cinq mois au retour, pour une simple signature. « Devant pareil exploit, McLouhghlin écrit à Simpson que, désormais, ses hommes seront libérés en Oregon, quoi qu’en pense ou fasse le ‘petit empereur’. »[13]
Les différends entre Simpson et McLouhghlin sont nombreux : outre le développement des réseaux de transport maritime océanique, un modèle mercantile très britannique, versus les réseaux terrestres s’appuyant sur les Voyageurs fréquentant des populations locales, leur philosophie de vie est fort différente. Ce différend sur leur approche commerciale respective reflète la divergence entre la vision francophone et anglophone en Amérique dans l’établissement de relations commerciales unissant le monde. Simpson vit à Montréal parmi la bourgeoisie anglophone qui domine le pays depuis la Conquête britannique. « Il est même dans les confidences des grands entrepreneurs canadiens, tel William Molson. »[14] De son côté, Jean-Baptiste McLouhghlin déclare à qui veut l’entendre son admiration pour le chef de la rébellion des Patriotes, Louis-Joseph Papineau : « Malgré les avertissements polis de ses hôtes qui lui rappellent que le chef de la rébellion des Patriotes n’est pas le sujet le plus populaire dans la compagnie britannique. »[15] McLouhghlin accueille même des Patriotes fuyant la répression britannique au Bas-Canada.
En 1839, une lettre de Montréal le convoque à Londres en l’enjoignant de prendre le prochain bateau passant par le Cap Horn. Jean-Baptiste McLouhghlin craignant de perdre son poste et ne faisant qu’à sa tête, choisit la voie terrestre pour se rendre à Montréal, tout en prenant soin de saluer ses employés d’un poste à l’autre. À Londres, il impressionne tellement les dirigeants de la Compagnie qu’il obtient tout ce qu’il veut, entre autres la fin des engagements par signature en Oregon, et la mise sur pied d’une petite compagnie agricole indépendante pour faire le commerce avec les colons des États-Unis qui arrivent. C’est ainsi que la vallée de la Willamette, qui représente une terre paradisiaque à la source de l’Oregon, sera rebaptisée The French Prairies par les colons anglophones.
La route vers l'Oregon

À l’image des Canadiens d’origine, McLoughlin a propagé cet esprit d’ouverture à l’autre jusqu’à la limite ouest du continent. Les autochtones de la région le respectent : « Les Clatsop le surnomment avec respect l’Aigle à tête blanche. »[16] Tout comme cet oiseau symbole des États-Unis, Jean-Baptiste McLoughlin représente les véritables pionniers de l’Ouest de l’Amérique. Ce rêve de liberté, de fraternité et d’égalité qui inspire l’épopée des Lumières dans le monde entier trouve un dernier espace d’épanouissement à cette frontière du monde connu. La récupération commerciale de cet esprit de liberté profitera à une élite poursuivant un idéal de richesse et de pouvoir. Les biographes anglophones de McLoughlin « n’ont jamais trop insisté sur le fait que l’anglais n’était pas la langue de travail au fort Vancouver, pas plus qu’ils n’ont souligné le caractère hautement multiculturel de l’environnement humain. »[17] Michel Laframboise avec Louis Pichette, responsable de la vallée de Sacramento dans le nord de la Californie ouvre la piste Siskiyou dont le point d’arrivée, nommé French Camp, marquera la fin du périple pour des milliers de colons qui ont pris le chemin de la Californie au cours du XIXe siècle.[18] Le chemin vers un monde nouveau de liberté plus à l’Ouest, vers le rêve californien, fut tracé par les ancêtres des Québécois. Toutefois, l’histoire des Francophones d’Amérique ne cadre pas avec la culture des Anglo-américains qui prétendent être les précurseurs d’un monde nouveau de liberté et d’ouverture, un modèle unique qu’ils veulent imposer aux autres cultures.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Cliquer ici pour soutenir l’expression d’un Québec Pur Sirop →
[1] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p239
[2] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p264
[3] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p267
[4] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p241
[5] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p283
[6] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p286
[7] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p287
[8] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p289
[9] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p288
[10] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p290
[11] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p290
[12] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p288
[13] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p295
[14] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p296
[15] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p296
[16] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p286
[17] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p287
[18] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p290
© Bastien Guérard, 2021
La conquête de l’Ouest est le plus souvent illustrée par le cowboy. Le bûcheron y occupe une place plus discrète. Pourtant, son rôle a été de première importance. L’aventure de l’Ouest a exigé beaucoup de bois pour la construction de divers bâtiments. Il a fallu toute une organisation pour l’abattage des arbres, le transport des troncs, le sciage et la distribution des planches. Or, étant donné que dans les Prairies le bois fait défaut, on a dû aller le chercher dans les forêts du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota. C’est ainsi qu’à la fin de l’époque de la traite des fourrures, dans cette région de l’Amérique les bûcherons succèdent aux coureurs des bois. La nécessité de s’adapter à une nouvelle réalité et de répondre à de nouveaux besoins pousse plusieurs coureurs des bois à changer de métier.
Certains coureurs des bois, en devenant draveurs, demeurent dans le monde des rivières en pratiquant un métier des plus dangereux de l’histoire. Ils doivent faire descendre des billots de bois dans les rivières. Ils courent sur les billots flottants pour dégager, à l’aide d’une longue tige de bois terminée par un crochet, les embâcles bloquant le transport du bois. Dans les eaux glacées du printemps, tomber à l’eau entre les billots, c’est presque la mort assurée.[1] Le mode de transport des billots a changé, mais l’industrie du bois demeure bien vivante en Amérique du Nord depuis le début de la colonisation.
Au Michigan, les Canadiens d’origine meublent les légendes de bûcheron. De cette saga du Midwest, un bûcheron légendaire émerge : le géant Paul Bunyan, symbole du vaillant travailleur américain défricheur du pays. Tous les enfants américains apprennent l’histoire de Paul Bunyan, the Giant Lumberjack. Cette légende serait inspirée de la vie de Fabien Joseph Fournier, arrivé en 1865 au Michigan à l’âge de 18 ans. Patron dans un camp de bûcherons, il fut reconnu pour sa force légendaire. Témoignant de la forte présence française dans la région, le monument aux bûcherons du Michigan se trouve dans un parc sur le bord de la rivière aux Sables : ce nom de rivière témoigne clairement de la présence francophone dans la région.[2]
Bien que les noms de Paul Bunyan et de Fabien Joseph Fournier ne se ressemblent pas, il demeure que de nombreux habitants du Michigan portent des noms francophones déformés : serait-il possible qu’il s’agisse ici du même homme? L’analphabétisme des premiers colons francophones a entraîné la déformation de leur nom de famille, retranscrit selon la sonorité anglaise : Bone pour Beaune, Thebau pour Thibault, Courtway pour Courtois, DeGonia pour DesGagnés, Pashia pour Pagé.[3] Cette transcription des noms des premiers colons contribue à effacer de l’histoire ces colons francophones, mais ouvre la porte à transformer leur histoire en légende. Lorsqu’un Charles Hurtubise devient un Charles Oautobees, il devient difficile de visualiser les traces de ces francophones qui ont ouvert l’Amérique.[4] Comme ils ne savaient pas écrire, ils n’ont pas su enjoliver leur vie comme l’on fait Kit Carson, Jim Bridger et James Beckwourth, en écrivant eux-mêmes ou en faisant écrire l’histoire de leurs exploits.[5] De plus certains changent de nom pour faciliter leur intégration à l’univers de l’Ouest américain de plus en plus anglophone.
Durant toute la période de la Conquête de l’Ouest, des Canadiens d’origine poursuivent également un certain rêve de liberté. Au cours de cette épopée, plusieurs d’entre eux marqueront l’histoire par leur esprit de liberté et d’aventure. Le mythe du cowboy n’y fait pas exception. Les Canadiens d’origine font partie de ces pionniers du rêve américain de liberté. À l’âge de 11 ans, Thomas Beausoleil part du Québec en direction de l’Ouest. Après des années d’errance sur les routes de l’Ouest où il travaille dans les mines, il fait même la connaissance du légendaire Buffalo Bill. Vers 1870, il s’achète un grand terrain à Devil’s Gate sur la route de l’Oregon et de l’Utah. Il devient le premier rancher du Wyoming, ce pays des cowboys américain. Aujourd’hui, il est connu sous le nom de Tom Sun, car Thomas Beausoleil n’a pas une sonorité anglaise facilement assimilable. [6] En 1960, son ranch a été déclaré National Historic Landmark. Déjà en 1882, le journal « The Cheyenne Daily Leader » indique que pour avoir une idée d’un ranch, le mieux serait de décrire celui de Tom Sun.[7] Après quatre générations d’éleveurs, le Sun Ranch fut vendu en 1996.
Ranch de Thomas Beausoleil - Tom Sun Ranch à Devils Gate au Wyoming

Nous retrouvons les gens de la vallée du Saint-Laurent dans tous les domaines de l’aventure de la conquête de l’Ouest. L’une des ruées vers l’or dans le Montana commence en octobre 1869 lorsque Louis Barette et Basile Lanthier trouvent de l’or dans les montagnes de Cœurs d’Alène. Manquant de matériel, ils retournent à Frenchtown acheter des provisions; l’un des deux vend la mèche au propriétaire du magasin général Adolphe Lozeau. Dans les jours qui suivent, la nouvelle se répand comme une traine de poudre. Dans le courant de l’hiver suivant, plus de mille chercheurs d’or arrivent dans la région. [8]
L’épopée francophone dans l’Ouest commence bien avant : la fondation de Frenchtown remonte à 1858 lorsque Jean-Baptiste Ducharme et Louis Brown (un Lebrun anglicisé ?) s’installent dans ce lieu avec leur famille métis après avoir fui les guerres indiennes de 1855-1856. [9] Les régions du Nord-Ouest représentent l’ultime frontière pour ces gens en recherche d’un coin de liberté pour élever une famille. La région est marquée par une forte influence francophone. Les tribus amérindiennes de la région portent des noms savoureux comme les Nez-Percée, Cœur d’Alène ou Têtes Plates.
Le transport des marchandises se situe au cœur de la vie de bien des francophones lors de l’ouverture du continent. En 1832, Pierre Cadet Chouteau introduit le premier bateau à vapeur sur le Missouri. Aujourd’hui, la capitale du Dakota du Sud porte son prénom.[10] Certains francophones se sont illustrés autrement; François-Xavier Aubry est connu pour ses convois rapides et sécuritaires qui sont utilisés par des gens de tout horizon. Ce convoyeur couvrant les routes de Saint-Louis à Santa Fe inspire des entreprises comme le Pony Express fondé en 1848. « Certains historiens feront même le rapprochement entre l’image du cavalier Aubry et le logo de la compagnie – ce qui est loin d’être farfelu, considérant l’admiration qu’éprouvait un des cofondateurs pour lui et plus encore, pour sa belle Dolly. »[11]
La conquête de l’Ouest a été balisée par les francophones d’Amérique. Ils ont disparu à travers les légendes ou servent de références pour illustrer l’aventure de la conquête de l’Ouest, comme ce « François-Xavier Aubry, le flamboyant ouvreur de pistes et riche convoyeur de l’Ouest américain, assassiné à Santa Fe en 1850 dans le saloon des frères Mercure, deux taverniers de Québec. » [12]
Après lui avoir donné une certaine saveur en jalonnant le chemin des signes de leur présence, les Canadiens d’origine se sont dissous dans le paysage américain. Les colons à la poursuite du bonheur ont suivi la piste de la Californie, ouverte par Michel Laframboise et dont l’extrémité se nomme French Camp dans la vallée de Sacramento.[13] Des milliers de colons suivront les traces des Canadiens d’origine pour se rendre dans l’Ouest à la poursuite de leur rêve. Les Canadiens d’origine participent à la construction d’infrastructures permettant l’accueil des colons américains, comme les routes, mais également d’autres éléments de base comme la construction de moulins pour le blé ou l’organisation de l’accès à l’eau potable.
Louis Robidoux est arrivé à Los Angeles en 1844, après l’achat d’un ranch, il construit en 1846 le premier moulin à farine de la Californie du Sud. À l’instar des autres français présents dans la région, il aide le général américain Frémont à s’emparer de la Californie.[14] Les francophones sont très présents en Californie à l’époque, comme la rue Marchesseault à Los Angeles commémore l’un de ses nombreux Canadiens d’origine. Après avoir construit la première glacière à Los Angeles en 1859, avec son partenaire Victor Beaudry, le marchand de glace Damien Marchesseault devient maire de Los Angeles à trois reprises entre 1859 et 1867. En vendant de la glace dans les saloons, ce gars né à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu dans le Bas-Canada, semble avoir développé beaucoup de relations et beaucoup de vision. « En 1863, il construit, avec Charles Lepaon, le premier système de distribution générale d’eau. » [15]
Dans les années 1870, la ville de Los Angeles a pour maire Prudent Beaudry. À la même époque, son frère Jean-Louis Beaudry sera le maire de Montréal. Un destin familial qui, à l’image de bien des francophones de l’époque, explore l’Amérique du Nord à la recherche d’une nouvelle forme de liberté. Durant la ruée vers l’Ouest, la ville San Francisco publie un journal francophone, L’écho du Pacifique.[16] Ironiquement, L’écho du Pacifique sonne la fin d’une partie de la culture francophone d’Amérique du Nord qui dans sa grande aventure vers un monde de liberté opta pour une fuite en avant vers l’Ouest. Peu de littérature existe, seul un vague écho de cette grande saga francophone résonne encore.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Cliquer ici pour soutenir l’expression d’un Québec Pur Sirop →
[1] Florian Girard, ancien draveur, Lotbinière, 2004, communication personnelle
[2] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[3] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[4] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p338
[5] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p343
[6] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Sun_Ranch
[8] https://missoulian.com/news/local/mineral-county-marks-th-anniversary-of-cedar-creek-strike/article_b7410665-a2c4-534b-bcc2-74200a85690d.html
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Frenchtown,_Montana
[10] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p333
[11] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p371
[12] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[13] https://fr.wikipedia.org/wiki/French_Camp_(Californie)
[14] https://www.linkedin.com/pulse/les-français-et-autres-pionniers-francophones-à-los-angeles-lebon/
[15] https://www.linkedin.com/pulse/les-français-et-autres-pionniers-francophones-à-los-angeles-lebon/
[16] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p369
© Bastien Guérard, 2021
Depuis le XIXe siècle, le nom de Lord Durham évoque la volonté de faire disparaître de l’Amérique du Nord la culture des Canadiens d’origine. En réponse à la rébellion des Patriotes, la rapport Durham laisse voir une volonté d’assimilation des francophones d’Amérique : il « appuyait son idée sur ce qui lui apparaissait comme deux évidences : l’Amérique du Nord parle anglais, et l’anglais est une langue supérieure parlée par une race supérieure ».[1] Comme il n’a pas daigné rencontrer les représentants élus de la culture francophone d’Amérique lors de son passage au Bas-Canada, il n’a pas pu savoir qu’en 1839 la langue anglaise n’occupait pas encore tout le paysage linguistique de l’Amérique du Nord.[2] L’anglais est bien la langue principale dans l’univers anglophone concentré sur la Côte-Est. Toutefois, le français et l’espagnol sont les langues européennes les plus répandues sur le continent, auxquelles s’ajoutent l’algonquin et le sioux comme importantes langues de commerce, sans compter les centaines d’autres langues autochtones présentent sur le continent. « C’est sur la côte ouest que se trouvaient les concentrations de population les plus importantes, les plus évoluées et mieux organisées de tout le continent. » [3] À l’aube du XXe siècle, le « jargon de chinook » laisse encore voir un univers culturel ouvert à la diversité de ce monde disparu au profit du modèle socioéconomique anglais.
À l’instar de plusieurs peuples amérindiens, le « jargon de chinook » a intégré des mots français à son vocabulaire pour faciliter l’expression de notions abstraites. Pour beaucoup d’autochtones, l’accès aux savoirs de l’Ancien Monde passe par la langue française en raison du grand respect démontré envers eux par les Francophones comparativement aux autres locuteurs de langues européennes. Représentant un choix plus intéressant pour l’échange de savoirs, le français est devenu la langue d’un autre type de colonisation en Amérique. Le peuple métis du Manitoba fut le plus fort symbole de cette colonisation alternative. La colonisation française en Amérique du Nord étant plus éparpillée se devait d’être plus ouverte à l’intégration de nouveaux idéaux et à la mixité des peuples. Cette approche a conduit des Premières Nations vers une culture plus francophile. Les Canadiens d’origine répandus sur le continent furent les hérauts de la colonisation francophone alternative en Amérique : « Ils étaient colons à la rivière Rouge, premiers cultivateurs dans le grand Oregon, dans la vallée de la Willamette, et ils étaient colons, Amérindiens et Canadiens ensemble en Alberta et dans le nord de la Saskatchewan, avec des maisons qui ressemblaient à celles des premiers colons du Québec. »[4] Cette colonisation représente la première vague de colonisation portée par le commerce de biens et l’échange de connaissances. Elle donne lieu à de nouvelles communautés de personnes coopérant à l’avancement du bien être humain en fonction des paramètres socio-environnementaux locaux. Plusieurs mondes métissés apparaissent dans cette mouvance historique modifiant profondément l’Amérique.
La seconde vague de colonisation en provenance de la Côte-Est anglo-américaine avait pour but l’établissement d’un mode de vie basé sur un système économique fondé sur l’accumulation de la richesse par l’extension de sa puissance. Cette colonisation modifie l’environnement en peuplant le territoire de vaches au lieu de bisons et en remplaçant les chemins qui marchent par des chemins de fer, plus efficaces pour l’exploitation des ressources naturelles. Devant cette conception de rentabilisation du territoire faisant appel à de nouvelles technologies, le monde ancestral vivant en harmonie avec son environnement disparaît. La production de biens de plus en plus complexes conduit à de nouvelles relations sociales basées sur l’exploitation. En conséquence, la culture du partage et de la bienveillance s’efface devant la cupidité érigée en système.
Le mythe de la Destinée manifeste s’installe, les aventuriers francophones disparaissent au profit de trappeurs anglophones dans la mémoire historique construite de toute pièce par des écrivains américains.
« Les racines du surgissement mémoriel de ces trappeurs se situent précisément là : ils sont les figures d’un passé qu’on a transformé il y a longtemps en un mythe, celui de l’Ouest d’avant que les États-Unis ne s’y imposent réellement. La patrimonialisation débute en fait dès les années 1830 avec les premiers textes littéraires américains, ceux de James Fenimore Cooper ou de Washington Irving, quoique la présence française soit déjà marginale dans ces récits, tout comme dans la masse de dime novels qui suivra durant tout le XIXe siècle.»[5]
L’histoire des Canadiens d’origine parcourant l’Amérique est peu mise en lumière par les écrivains des États-Unis. Dans le cas du roman Astoria de Washington Irving, en plus de reformuler le récit de Franchère, l’auteur méprise sa culture francophone d’Amérique.[6] Autrement, les écrivains réfèrent toujours au Français de France, comme si tout ce qui est français en Amérique avait été parachuté de France. Les écrivains regardent le passé avec les yeux de leur époque, à un moment où la traite des fourrures a disparu et, avec elle, les Canadiens d’origine. À l’époque de la colonisation, les francophones n’ont pas été parachutés pour expliquer la présence du French Camp dans la vallée de Sacramento au bout de la route vers la Californie. Pourtant, si vous consultez un manuel d’histoire américain, « vous constaterez que tout nom de personne ou de lieu à consonance française sera dit « of french origin ». Il est très rare de souligner que ce français-là est d’origine canadienne.»[7] Les manuels parlent que des French Fur Trappers et de la French and Indians War oblitérant l’histoire des Canadiens d’origine en Nouvelle-France et en Louisiane. Très peu d’Américains, même éduqués, reconnaissaient d’emblée l’importance de la contribution des Canadiens d’origine dans leurs mythes fondateurs.
Trace francophone dans le nom de capitale d'État

Toute la reconnaissance des États-Unis envers l’impact francophone dans leur histoire se limite à La Fayette, un général français qui dirigea les efforts de guerre de la France en appui à la Révolution américaine contre la Couronne britannique. Autrement, les Américains, comme ils se nomment pompeusement pour se glorifier, demeurent très discrets sur le rôle des Francophones d’Amérique dans l’exploration et la constitution de réseaux commerciaux à la grandeur du continent. La démonstration de la fraternité des Canadiens d’origine avec les nations amérindiennes pourrait mettre en lumière l’altruisme des civilisations autochtones. Une histoire ne cadrant pas avec celle des Sauvages que les colons anglo-américains ont combattus avec acharnement pour leur apporter la civilisation, qu’ils disent américaine!
Peu de personnes osent remettre en question l’histoire prestigieuse que s’est donnée la puissance mondiale dominante. L’histoire du monde est toujours celle des vainqueurs. Dans les films hollywoodiens, la poursuite d’un rêve de liberté francophone dans l’Ouest est inexistante. Les coureurs des bois francophones ont plutôt le mauvais rôle dans l’imaginaire hollywoodien. Comme dans le film The Revenant, pour lequel l’acteur québécois Roy Dupuis a refusé de jouer le rôle du trappeur Toussaint qu’il commente ainsi : « Quand j’ai réalisé la façon dont les trappeurs français sont traités, j’ai trouvé cela tout simplement insupportable. Ils ont le pire des rôles! »[8] Embrassant la culture des États-Unis, un acteur de France accepta de jouer le rôle de Toussaint, qui avec son accent européen renforce la négation de la présence des Canadiens d’origine dans l’Ouest.
De cette saga vers l’Ouest racontée par la culture anglo-américaine, seul Louis Riel, le Métis fondateur du Manitoba, est rappelé à la mémoire québécoise : il fut pendu par les Anglais pour avoir créé une province à l’image d’un monde métis contrevenant à la volonté divine d’une mythique Destinée manifeste. Un rappel que la création d’un modèle unique de consommation, conforme à la nouvelle culture commerciale anglo-américaine, ne tolère pas la nuance.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[2] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[3] Germain, Georges-Hébert,Les coureurs des bois, saga des indiens blancs, Edition Libre Expression, 2003 p23
[4] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[5] http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-32/Trappeurs_francophones_des_Plaines_et_des_Rocheuses_étatsuniennes.html#.XjWVDy0lCYN en ligne 20 décembre 2020
[6] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p267
[7] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf en ligne 20 décembre 2020
[8] https://www.journaldemontreal.com/2016/01/23/roy-dupuis-sen-prend-au-film-the-revenant en ligne 2 novembre 2020
© Bastien Guérard, 2021
Dans les manuels anglais, la grande histoire du Canada commence véritablement après la French and Indians War. Au Québec, dans les manuels francophones, ce même épisode se nomme La Conquête et représente un tournant après 150 ans d’existence auprès d’alliés autochtones sous la gouvernance de la France. Une époque charnière où les Francophones d’Amérique se retrouvent seuls devant un avenir incertain. Leurs fondements culturels sont ébranlés par le changement de régime. L’Église catholique en prenant en charge l’éducation des Francophones d’Amérique a contribué à effacer de leur mémoire leurs racines culturelles autochtones d’avant la Conquête. L’Église les force à accepter l’idée que la destinée des peuples d’Amérique doit s’accomplir selon la culture religieuse dominante. Ainsi, une trame de l’histoire des Francophones d’Amérique disparaît de l’histoire officielle, ici et en France catholique. La religion est un vecteur de mensonge historique à l’échelle internationale.
L’autre monde possible en Amérique, évoqué par les Canadiens d’origine est ignoré de l’histoire anglo-américaine, mais également de l’histoire française. Et par extension de la mémoire planétaire, car la France représente un phare culturel universel. La France traite l’histoire de la Nouvelle-France à la façon hautaine d’un Voltaire la considérant uniquement pour ses quelques arpents de neige. « Aux mensonges mythiques de l’histoire du continent, les Français dansent avec les Américains, fabulateurs réunis pour effacer la marque canadienne-française dans l’espace. »[1] Tout comme aux États-Unis, la gloire de la France en Amérique ne passe que par le général Lafayette lors de la Révolution américaine. La vente de la Louisiane représente la poursuite de la contribution de la France à l’expansion du rêve de liberté en Amérique : une sorte d’approbation de l’expansion de la culture de la Destinée manifeste vers l’Ouest. Depuis l’époque des Lumières, la France vit toujours sur un prestige culturel lointain lui venant de l’époque de la Nouvelle-France. Envers l’histoire de sa colonie en Amérique du Nord, elle se comporte toujours comme ses rois à l’époque des grandes expéditions d’exploration : elle n’est pas prête à y investir, mais toujours disposée à en retirer tout le prestige et la richesse qui en découle. Ainsi, selon elle l’époque des Lumières conduisant à la Révolution française ne saurait avoir d’autre origine que française. Alors qu’il est connu que l’idée du Bon Sauvage du philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, a pour origine les compagnons des colons de Nouvelle-France.
La France n’a jamais démontré de respect pour ses fils de Nouvelle-France. En accordant plus attention à la cour de France qu’au changement en cours dans le Nouveau Monde, le Royaume de France n’a pas vu venir les changements dans la marche du monde. L’effondrement de son royaume s’explique en partie par son inconscience de la culture singulière des colons de Nouvelle-France imprégnée de sagesses autochtones. Son arrogance nourrissant son ignorance a conduit à la perte d’un riche royaume. À ce sujet, la mention suivante concernant la famille de La Vérendrye qui découvrit les Rocheuses, est éloquente : « Une liste militaire disait de Louis-Joseph en 1760 : Chevalier de La Vérendrye, fortune médiocre, connu de tous les Sauvages. » [2] Cette description illustre bien le fossé culturel entre les Canadiens d’origine et la mère patrie. Pendant la guerre de Conquête, De la Vérendrye et son frère « guident une coalition de huit nations amérindiennes des Grands Lacs venues faire la guerre aux côtés des Français dans la région du lac Champlain. »[3] De plus, les De La Vérendrye forment une grande famille d’explorateurs : ils ont fait des découvertes majeures sur les principaux réseaux hydrographiques en Amérique du Nord, entre autres la découverte des sources du Mississippi vers 1735. « Les notes de l’explorateur sont demeurées enfouies dans les Archives nationales de France où, pendant plus d’un siècle, personne ne les a consultées. »[4] Donc, les rapports d’explorations de La Vérendrye furent consultés bien après la vente de la Louisiane par Napoléon en 1803 : il n’est pas étonnant que la France l’ait vendue aux États-Unis pour une bouchée de pain.
La formule de Napoléon voulant que « L’Histoire est une série de mensonges convenus » s’applique très bien à la vente de la Louisiane fondée par la France. Il serait plus juste de dire que la Louisiane est d’origine canadienne : Joliet a découvert le Mississippi, Pierre Le Moyne d’Iberville a fondé la Louisiane en localisant l’embouchure du fleuve dans le golfe du Mexique ; la famille La Vérendrye en a trouvé la source de ce fleuve sur les contreforts de Rocheuses en empruntant la rivière Missouri. Toutes ces expéditions devaient s’autofinancer grâce aux possibilités de commerce qu’offraient ces explorations. Les Canadiens d’origine envisageant un monde nouveau ont permis à la Nouvelle-France d’atteindre sa grandeur. Ce n’est pas l’esprit français qui inspirait leur pensée, mais bien une philosophie de vie davantage adaptée au Nouveau Monde.
En Louisiane, la fondation de Bâton Rouge laisse entrevoir l’humeur des Canadiens d’origine : « Le fameux bâton rouge a vraiment existé́ : il s’agissait d’un poteau rituel, peint, qui marquait la limite des territoires entre les Natchez et les Choctaws. Ce sont les marins canadiens du pirate d’Iberville qui nommèrent l’endroit Bâton-Rouge. »[5] L’installation à Bâton-rouge démontre encore la philosophie de neutralité, de pacification et de progrès faisant le succès des Canadiens d’origine. Le frère d’Iberville, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, fonde la Nouvelle-Orléans. Il devient le gouverneur de la Louisiane de 1703 à 1713, puis de nouveau de 1716 à 1724 et encore de 1733 à 1743. Par la suite, certains des Acadiens déportés de leur terre en 1755 trouvent refuge en Louisiane où ils devinrent les Cajuns. La Louisiane est principalement l’œuvre de francophones nés en Amérique, provenant de Nouvelle-France et d’Acadie. La vente de la Louisiane par Napoléon pour financer ses guerres en Europe a pour ainsi dire effacé de la mémoire mondiale sa fondation par les Canadiens d’origine et ce refuge pour des Acadiens déportés.
Sylvie Dubois, professeure en études françaises à l’Université́ d’État de la Louisiane, qui avec les chercheurs Emilie Gagnet Leumas et Malcom Richardson, a plongé dans les archives de La Nouvelle-Orléans suite à l’ouragan Katrina, est catégorique : « durant le régime colonial français, la vraie mère patrie de la Louisiane, indiquent les chercheurs, n’est pas la France, mais plutôt le Québec. » [6] La Louisiane fut l’œuvre des Canadiens d’origine et des Acadiens en Amérique, mais seule la France en tira profit.
En 2016, lors d’une commémoration marquant le tricentenaire de la mort d’Iberville à La Havane, la France est absente : « Pour ce qui est de la France et de sa représentation consulaire à La Havane, j’observe qu’elle ne s’est pas manifestée lors de la commémoration de juillet 2006 : raison de plus, diront les Québécois, de réclamer « l’exclusivité́ » sur la mémoire du héros. »[7] Pour la France, la Louisiane française fut simplement un joli trait frontalier sur des cartes de l’Amérique du Nord. Et son majestueux fleuve Mississippi traversant le continent fut sans doute perçu comme quelques arpents de neige fondue.
Pour un Français écrivant sur l’histoire du Far West aux États-Unis, il est inconvenant « d’informer ses lecteurs que la Yellowstone River s’appelait au départ Rivière Roche Jaune pour avoir été fréquentée par les Canadiens français, plusieurs années avant l’expédition de Lewis et de Clark dans l’Ouest. »[8] Lorsque la France, cet ancien empire colonial rayonnant toujours dans la francophonie planétaire, ne reconnaît pas les succès de ses enfants d’Amérique, la mémoire internationale de cette magnifique saga s’efface à grande échelle. La France honteuse d’avoir délaissé cette Amérique francophone, évite de mettre en lumière que le nom de la ville de Provo en Utah provient du découvreur du Grand Lac Salé, Étienne Provost, qu’un François-Xavier Aubry a ouvert la piste entre Saint-Louis et Santa Fé, que les Ozark Montains s’étendant sur les États du Missouri, de l’Arkansas, de l’Oklahoma et du Kansas, se nommaient Monts Aux Arcs sur les premières cartes. Aux États-Unis, la Canadien River traverse Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique et prend sa source au Colorado.
Bassin de la Canadian River aux États-Unis

L’histoire des Canadiens d’origine, en France comme ailleurs, ne convient pas à l’histoire officielle destinée à pour faire accepter au monde le modèle économique des États-Unis. Le monde des affaires doit son succès à l’acceptation du dogme religieusement mercantile d’une Destinée manifeste que représente l’histoire des États-Unis. La mémoire de la saga des Canadiens d’origine à travers l’Amérique fut récupérée pour servir les canons de l’imaginaire collectif basé sur la Destinée manifeste d’un peuple se proclamant américain : « La nature fragmentaire des sources sur les voyageurs et leur assujettissement aux domaines commerciaux et politiques les ont relégués aux confins de la plupart des récits historiques. »[9] Aujourd’hui, le pays prétend avoir la générosité de partager son esprit mythique de liberté à travers le monde. Cette rhétorique justifie la présence américaine dans de nombreux pays. Dans la mythologie mondiale, cette présence ne peut signifier autre chose que l’accès à la liberté. Le mythe du cowboy sur son cheval demeure un puissant symbole de liberté à travers le monde. Lucky Luke doit venir dans La Belle Province pour entendre la langue de Molière, car les francophones d’Amérique sont exclus de ce mythe de liberté dans l’Ouest.
Les Révolutions américaines et françaises furent les phares de l’époque des Lumières libérant le monde des monarchies de droit divin. La Révolution française fut laïque contrairement à la Révolution américaine qui conserva la religion pour construire son mythe de la Destinée manifeste. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, la religion reprend du galon en France. Le succès des États-Unis dans sa conquête de l’Ouest à l’ère industrielle redore le prestige de sa révolution. La France abonne l’esprit de l’épopée des Lumières reposant sur la science à la faveur des ténèbres religieuses en offrant la Statue de la Liberté aux États-Unis. Depuis, la France embrasse l’histoire des États-Unis pour en tirer du prestige. En France, l’histoire de la Nouvelle-France fut effacée comme quelques arpents de neige au soleil.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[2] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p194
[3] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p192
[4] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p187
[5] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[6] Nadeau, Jean-François, L'Église a joué un rôle dans la disparition du français en Louisiane, Le Devoir, 22 mars 2018
[7] « Pierre Le Moyne d’Iberville (1706-2006) : trois siècles à hue et à dia », Cahiers des Dix, Québec, no 60, 2006, p. 79-101.
[8] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[9] Carolyn Podruchny, Les Voyageurs et leur monde. Voyageurs et traiteurs de fourrures en Amérique du Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, p.
© Bastien Guérard, 2021
Aux États-Unis, le cheval mythique demeure le cheval Morgan. Baptisé Figure, cet étalon aux capacités prodigieuses fut la propriété de Justin Morgan du Vermont. Les Américains ont créé une légende de cet étalon si bien proportionné, le considérant à tort comme le premier cheval d’une race purement des États-Unis. Tellement incrusté dans la légende américaine qu’en 1972, Walt Disney produit le film Justin Morgan had a horse. Ce fameux cheval Morgan vient du Vermont, un territoire de la Nouvelle-France concédé par l’Acte de Québec en 1774 et où d’anciennes fortifications témoignent encore de la présence française pour contrer les attaques mohawks par le lac Champlain. Les analyses génétiques ont démontré que les chevaux Morgan descendent de la race de chevaux Canadien. L’histoire de Figure démontre encore une fois qu’une grande légende américaine prend son origine au Québec.
Le cheval Canadien est le descendant des chevaux envoyés en Nouvelle-France par Louis XIV à partir de 1665 pour soutenir la colonie dans son développement. Le cheval est la machine de l’époque, d’où l’origine du mot chevaux-vapeur pour mesurer la force motrice. Ces chevaux arrivent à un moment crucial pour la survie de la Nouvelle-France, juste après la prise de possession de la Nouvelle-Hollande par l’Angleterre. Cette conquête anglaise pousse le roi de France à investir en Nouvelle-France pour garantir le maintien de sa colonie en Amérique du Nord. En plus du régiment de Carignan pour défendre la colonie, des Filles-du-Roi pour son peuplement, les meilleurs chevaux de son écurie sont également envoyés en Nouvelle-France pour renforcer le développement du pays. Dans les années suivantes, un contingent de 82 chevaux, ayant survécu à la traversée de l’Atlantique, feront souche en Nouvelle-France. Originaires principalement de Bretagne et de Normandie, ce sont des chevaux polyvalents pouvant autant tirer des charges que servir de monture, fonctions utiles au service militaire.
Les chevaux sont distribués à des communautés religieuses ou à des personnes de confiance sous une condition : remettre aux 3 ans un poulain à l’administration de la colonie. Les poulains sont redistribués sous les mêmes conditions, favorisant ainsi la constitution d’un cheptel qui atteint plus 15 000 chevaux en 1760 sur un territoire allant du Labrador à la Louisiane. Pendant plus de 100 ans, les chevaux envoyés par Louis XIV se reproduiront entre eux en Nouvelle-France dans de rudes conditions pour former une nouvelle race. Ce cheval appelé Le petit cheval de fer par les colons, démontre sa force et sa résistance à divers travaux dans de rudes conditions tant hivernales qu’estivales. Puissant et très polyvalent, il sert à défricher, à labourer, à tirer une carriole ou un tonneau sur ski lors de la récolte de l’eau d’érable. À la Conquête, les Britanniques reconnaissant les qualités du cheval Canadien, des milliers de bêtes seront envoyées dans leur colonie au Sud.
Au cours du XXe siècle, la mécanisation des transports et de l’agriculture rend les chevaux moins utiles. Déjà au XIXe siècle, le cheval Canadien entre en compétition avec son sous-produit, le cheval Morgan des États-Unis. La sauvegarde de la race nécessite l’intervention des gouvernements provincial et fédéral de l’époque : depuis 1999 le cheval Canadien est reconnu comme race patrimoniale du Québec au même titre que la poule Chanteclerc et la vache Canadienne. Le cheval Canadien devient le cheval national du Canada en 2002. Malgré cela, cette race légendaire est en voie d’extinction.
Dans le but de la valoriser comme race patrimoniale, des amateurs de la race Canadien ont voulu connaître son impact sur le patrimoine génétique des autres chevaux d’Amérique du Nord. Parmi les irréductibles fans du cheval Canadien, Richard Blackburn a parcouru le chemin entre Québec et le Texas avec son cheval Canadienpour apporter des échantillons d’ADN de 50 chevaux Canadien. Un parcours de 4000 km, avec une moyenne de 56 km par jour, sans changer de monture. Son cheval a subi un écart de température de 40o C et a gravi 50 000 m de dénivelé pour franchir neuf chaines de montagnes. Les résultats d’analyse du Docteur Gus Cothran, directeur du laboratoire de la génétique équine de l’Université A&M du Texas, démontrent que le cheval Morgan est bien un descendant du cheval Canadien, mais également que l’ensemble des races de chevaux d’Amérique du Nord descendent du cheval Canadien.[1] Toutes les races de chevaux des États-Unis ont été développées par hybridation avec le cheval Canadien.
À l’image des Canadiens d’origine, le cheval Canadien est un animal très tolérant et très polyvalent pouvant s’atteler à toutes sortes de tâches. L’hiver, les colons laissaient les chevaux libres pour qu’ils se nourrissent seuls, se libérant ainsi d’une corvée supplémentaire. Pour leurs travaux, les colons n’avaient pas besoin de tous les chevaux. Ainsi, lorsque le troupeau devenait trop considérable, seuls les chevaux les plus dociles étaient gardés. C’est pourquoi le cheval Canadien est reconnu pour son calme et sa jovialité, même après une journée de dur labeur. Les chevaux plus farouches prenaient la clé des champs pour rejoindre des chevaux sauvages et devenir des chevaux Mustang, le mythique cheval sauvage des États-Unis.
Bien que les chevaux Mustang soient considérés comme étant les descendants des chevaux espagnols que les conquistadors avaient perdus lors de leur aventure mercantile, les analyses génétiques démontrent qu’une partie de leur patrimoine génétique provient du cheval Canadien. En 1732, lors de son expédition dans les Plaines de l’Ouest, de La Vérendrye amène avec lui près de 200 chevaux dont une quarantaine prendront la clé des champs. Ces chevaux sont à l’origine des Mustang du Nord qui se sont mélangés au cours des générations avec les Mustang du sud d’origine espagnole.[2] Connaissant l’origine des chevaux Mustang, le visionnement du film Hidalgo prend une signification particulière : ce film américain montre comment un cowboy métis sur son cheval Mustanggagne en 1890 une des plus prestigieuses courses de chevaux dans un désert du Moyen-Orient, contre des chevaux arabes et leurs prestigieux cavaliers bédouins. À son retour, avec l’argent gagné, il acheta un troupeau de Mustang pour les sauver de l’abattage. À l’époque, les chevaux devaient faire place à la modernité.
Au cours du XXe siècle, le troupeau national des chevaux Canadien est vendu à l’encan par le gouvernement. En 1970, la race risque de s’éteindre, car il ne reste plus que 400 chevaux Canadien de race pure. La race a été sauvée de l’extinction dans les années 1980 par une poignée de passionnés de chevaux. Selon André Auclair, directeur de la Fédération des producteurs de races patrimoniales du Québec (FPRPQ), il ne reste que 700 juments de race Canadien aptes à la reproduction.[3] La banque génétique de la FPRPQ indique qu’elle a « présentement en sa possession la semence congelée d’étalons de race Canadien pur-sang originel (dont la génétique remonte aux chevaux souches) représentant les six lignées mâles encore existantes dans la race. Ces lignées sont les suivantes : Ste-Anne Marquis de Bécancour, Thomas de Viger, Henryville Prince, Lou, La Gorgendière Royal et Brio de la Victoire. »[4] Le cheptel de chevaux Canadiens est peu nombreux, mais la forte diversité génétique de cette race d’origine l’a prémuni de problèmes de consanguinité.
Comme de La Vérendrye, d’autres explorateurs partiront de la vallée du Saint-Laurent avec des chevaux Canadienpour découvrir l’Amérique. À l’instar des Canadiens d’origine, le cheval Canadien servit discrètement et de multiples manières à la construction de l’Amérique. Plus de 40 000 chevaux Canadien participeront à la Guerre de Sécession pour soutenir l’effort de guerre nordiste. Les traces du cheval Canadien sont à l’image des Canadiens d’origine : elles se sont intégrées à l’évolution du pays léguant une ossature légendaire sur lequel les États-Unis se sont construits.
Le cheval Canadien a laissé sa trace dans la fabuleuse saga nord-américaine et demeure, un symbole de fierté à préserver. Pensez à lui en ouvrant votre prochaine boîte de sirop d’érable, pensez à combien de tonnes d’eau d’érable ces chevaux ont tiré sur des traineaux au printemps depuis le début de son exploitation au XVIIe siècle jusqu’à l’arrivée du tracteur. Notons que l’exploitation plus intense de l’eau d’érable coïncide avec le développement du cheptel de chevaux Canadien à la fin du XVIIe siècle. Pour garder bien vivante l’histoire du sirop d’érable, il faut y associer cette race de cheval légendaire.
Cheval Canadien travaillant à la récolte de l’eau d’érable

Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Leroux, Louise & Blackburn, Richard, La légende du cheval Canadien, documentaire, 2011, 52min
[2] Entrevue téléphonique avec André Auclair, directeur général, Fédération de producteur des races du patrimoine du Québec (FPRPQ), le 10 mars 2020
[3] Leroux, Louise & Blackburn, Richard, La légende du cheval Canadien, documentaire, 2011, 52min
[4] http://www.fprpq.com/cheval-canadien/banque-genetique/
© Bastien Guérard, 2021
L’élite anglo-américaine est portée à réécrire l’histoire de l’Amérique du Nord : cette tendance est d’autant plus forte que l’aventure des Canadiens d’origine et de leurs alliés autochtones est fabuleuse. L’acharnement des Anglais à détruire la mémoire de la Grande Alliance en Amérique du Nord est indéniable. Après la Conquête, l’Angleterre porte en Amérique du Nord son idéologie insulaire à un niveau continental. Après la Révolution américaine, le modèle de développement économique anglo-américain se justifie grâce au mythe de la Destinée manifeste du peuple américain. Cette idéologie impose une conception d’un monde éclairé par la volonté divine au service d’une nouvelle élite financière capitaliste. Elle est incompatible avec un modèle basé sur la bienveillance, l’harmonie et l’acceptation de l’autre.
Pour cette élite, la présence d’un monde alternatif dans le Nouveau Monde est intolérable. Son existence soulève un doute sur la divine perfection du modèle économique anglo-américain servant au maintien des privilèges de l’élite. Pour atteindre cette soi-disant parfaite civilisation, la déportation des Acadiens, le bombardement et l’incendie des villages et des fermes des Canadiens d’origine et une première guerre biologique à l’encontre des Amérindiens ont été nécessaires ; des crimes de guerre ont permis d’imposer un modèle économique toujours en usage au XXIe siècle. Ce modèle construit sur le mensonge, la peur et la violence se prétend porteur de liberté et de progrès pour l’humanité. Au XIXe siècle, le modèle de la Destinée manifeste part de la Nouvelle-Angleterre pour prendre de l’expansion vers l’Ouest du continent en imposant une civilisation unidimensionnelle. Le succès de ce modèle américain repose sur l’expansion de la Révolution industrielle dans un territoire vierge d’infrastructures humaines et détenant d’abondantes ressources naturelles.
La conquête de nouveaux territoires répond à un besoin d’expansion engendré par la croissance d’une population. Une population croît lorsqu’elle est bien adaptée à son milieu de vie grâce à l’intégration de techniques lui permettant de mieux exploiter son environnement. Cette notion s’applique à tous les peuples du monde bien avant la sortie des humains d’Afrique. Elle explique le besoin d’exploration de nouveaux territoires qui seront mis en valeur ou même conquis si nécessaire. Le succès des civilisations repose sur leur capacité à s’adapter à un environnement en constante évolution.
Dans l’histoire du monde, les peuples ont évolué de multiples manières pour répondre aux besoins de leur survie en fonction de leur réalité régionale. Les grandes découvertes faites par les voies océaniques ont provoqué la rencontre de civilisations totalement différentes rendant notre univers de plus en plus complexe et diversifié. Cette différence de cheminement historique a conduit à l’intégration du concept de l’évolution des sociétés, ouvrant la porte à l’époque des Lumières, aux Révolutions contre d’immuables monarchies de droit divin. L’envers de la médaille de la théorie évolutionniste est qu’elle introduit la notion de peuples supérieurs et inférieurs, civilisés et non civilisés, justifiant au besoin l’anéantissement des autochtones des nouveaux territoires.
Bien avant Darwin, les peuples conquérants ont imposé leurs coutumes. L’exploitation de nouveaux territoires fait appel à l’application des techniques et des coutumes du peuple conquérant, reproduisant ainsi ce qui a engendré son succès. L’imposition de l’idéologie sous-tendant les coutumes et l’usage des nouvelles technologies devient essentielle à la reproduction d’un mode de vie favorisant l’expansion d’un modèle.
Dans le cas de la colonisation européenne, cette idéologie est fondamentalement chrétienne. À l’époque, la religion justifie la domination d’un monarque sur le peuple. Avec l’apparition d’une bourgeoisie commerçante, l’Église chrétienne s’adapte à l’idéologie de démocratisation du capital par une forme de la démocratisation de la pensée chrétienne à travers les réformes protestantes. Ce schisme de l’Église crée une variété de croyances sur un même thème : la soumission à un être supérieur imaginaire vous garantissant la vie éternelle au Paradis justifie l’injustice sociale et l’exploitation des masses au profit d’une élite malicieuse. Les religions par leur contrôle du Bien et du Mal, et la peur de l’enfer contribuent au maintien d’une aliénation mentale facilitant l’exploitation du peuple.
L’effacement de la culture autochtone par l’Église chrétienne a été systématique en complicité avec les gouvernements successifs des colons européens. Dans cette recherche très chrétienne du Paradis perdu, les Européens christianisés arrivent par vagues successives en Amérique. Comme le dit si bien l’historienne cherokee Theda Perdue dans le documentaire 500 nations - l’histoire vue par les Indiens d’Amérique : « Les chrétiens ont été chassés de leur paradis terrestre, mais les Cherokees vivaient dans le leur ».
Après la Révolution américaine, le gouvernement des États-Unis engage des missionnaires pour convertir les autochtones à la religion chrétienne, mais également aux mœurs américaines, comme celle d’abandonner la culture du maïs au profit du blé. [1] Ainsi les autochtones, pour devenir égaux aux colons américains, doivent rejeter leur propre culture. Thomas Jefferson croyait fortement à l’intégration des Amérindiens dans la culture américaine. Toutefois, l’intégration des Amérindiens est à sens unique, les Anglo-américains étant trop imbus de leur puissance technique. Les échanges culturels demeurent limités par l’attitude exclusivement mercantile des Anglo-Américains envers les Amérindiens. Le premier obstacle à l’intégration des Autochtones dans le nouveau pays est le colon américain à la poursuite du bonheur sur un territoire sauvage, bonheur promis par les mythes du Nouveau Monde.
La hiérarchisation des relations au sein de la société britannique se perpétue dans la hiérarchisation des peuples dans le Nouveau Monde. Cette conception darwinienne du monde entrave les échanges culturels dans les postes de traite anglais, premier lieu de contact avec les autochtones : « Les Canadiens sont tout de même mieux vus que les Indiens et les Métis qui, eux, sont carrément interdits de séjour à l’intérieur du fort, sauf pour le commerce. »[2] Tout comme Metacomet, alias le Roi Philippe en Nouvelle-Angleterre, les autochtones, bien qu’ils adoptent les comportements des blancs, sont rejetés par une société anglaise très hiérarchisée dans sa conception du monde.
Les Francophones d’Amérique et les peuples autochtones représentent des entraves sur la route de la Destinée manifeste du pays. Plusieurs tribus d’Amérindiens sont imprégnées de la culture française; elles choisissent cette langue de confiance pour les relations avec les Européens ; « les Osages du Missouri ont longtemps exigé de négocier en français canadien avec le gouvernement de Washington. »[3] Cette condition devait être un obstacle de plus au rapprochement pour des descendants d’Anglais, rivaux des Français depuis des siècles. Depuis Guillaume le Conquérant, dernier conquérant de l’Angleterre, les Anglais semblent avoir toujours de l’amertume envers les Français. Dans ce contexte remontant aux Guerres de religion où l’Angleterre antipapiste lutte contre la France catholique, l’Autochtone francophile catholique devait être au bas de l’échelle de la valeur humaine pour les autorités de Washington.
Les pressions des colons pour s’installer toujours plus à l’Ouest sur des territoires autochtones, n’ont cessé de croître depuis la Conquête anglaise. La convoitise de ces territoires sauvages par des colons croyant fermement en leur Destinée manifeste, nourrit des conflits dans lesquels les Amérindiens sortent toujours perdants.
Plusieurs bandes autochtones semi-nomades se déplacent en fonction des ressources d’un environnement bienveillant. Souvent, lorsqu’elles reviennent de leur territoire hivernal, des colons ont déjà squatté leur territoire de culture estival. Cette situation, reliée à l’incompréhension des colons face à la différence culturelle autochtone, entraîne des conflits. Les Autochtones subissent les assauts répétés des colons. Après chacun des assauts, ils en sortent davantage affaiblis par la maladie, la famine, la perte de leur habitat, ainsi que celui de leur gibier. De leur côté, les colons subissant des pertes peuvent toujours revenir s’installer sur la Côte-Est et pour financer un nouveau départ vers l’Ouest, ils se proposent comme guide pour un groupe encore plus grand de colons. Les Autochtones signent traités après traités qui deviennent caducs pour toutes les raisons pouvant convenir au conquérant anglo-américain.
Les gouvernements des nouveaux États financent leur milice à même les terres conquises aux autochtones. Les miliciens sont des citoyens ordinaires à qui l’on donne un fusil, une paie et un lopin de terre. Les miliciens sont des hommes opportunistes, sans scrupules, ayant très mauvaise réputation aux yeux des militaires de carrière de l’armée américaine : connaissant le rôle inhumain joué par l’armée à l’encontre des Autochtones lors de la conquête de l’Ouest des États-Unis, les milices devaient être diaboliques. Le futur président Abraham Lincoln fut membre de la milice de l’Illinois ; pour 80 jours de service, il reçut 250 $ et 160 acres de terre ayant appartenu aux Autochtones. Comme pour bien d’autres colons, le service dans la milice de l’État lui permit de lancer sa carrière. Bien qu’il fût connu pour l’émancipation des esclaves noirs, il n’avait que du mépris pour les autochtones.[4]
La position intransigeante de Lincoln envers les Autochtones illustre bien que le système socioéconomique anglo-américain ne tolère aucune remise en question. Par contre, les esclaves noirs déracinés d’Afrique, imprégnés de la culture de leur maître, ne constituent plus une menace pour le système socioéconomique. Lincoln n’a aucun problème à mettre fin à l’esclavage aux États-Unis : en acquérant la liberté, les noirs aspirent à être de bons consommateurs américains, contrairement aux autochtones qui persistent à vouloir maintenir leur mode de vie. Lincoln, l’homme à la carrière politique la plus légendaire des États-Unis, illustre bien l’un des mensonges fondamentaux à l’origine de la nation : La liberté est conditionnelle au respect du dogme socioéconomique capitaliste des États-Unis.
Les Canadiens d’origine demeurent le trait union entre les cultures autochtones d’Amérique et l’Ancien Monde. Contrairement aux colons puritains anglais, repliés sur eux-mêmes sur la côte Atlantique, les pionniers français sont engagés pour faire la traite de la fourrure à travers le continent. Après leur engagement, seul un engagé sur trois demeure au pays : ceux ayant intégré un mode de vie lié à la traite de la fourrure et à certaines coutumes autochtones. L’exploitation de l’eau d’érable au Québec, plus de 70% de la production mondiale, témoigne encore de la relation particulière des colons français avec les autochtones.
Les noyaux de l’Amérique Francophone

Les colons français quittaient le carcan catholique de l’Europe, tandis que les colons anglais venaient en Amérique pour l’épanouissement de leur foi. C’est là que l’histoire du peuple se sépare de celle de l’élite. M. de Sénonville, gouverneur du Canada, écrivait à Louis XIV, en 1685 : « On a cru longtemps qu’il fallait approcher les sauvages de nous pour les franciser ; on a tout lieu de reconnaître qu’on se trompait. Ceux qui se sont approchés de nous ne se sont pas rendus Français, et les Français qui les ont hantés sont devenus sauvages. Ils affectent de se mettre comme eux, de vivre comme eux. »[5] Alexis de Tocqueville dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, aborde cette différence d’approche : « L’Anglais, au contraire, demeurant obstinément attaché aux opinions, aux usages et aux moindres habitudes de ses pères, est resté au milieu des solitudes américaines ce qu’il était au sein des villes de l’Europe ; il n’a donc voulu établir aucun contact avec des sauvages qu’il méprisait, et a évité avec soin de mêler son sang à celui des barbares. »[6] L’espoir d’obtenir la reconnaissance ultime, le titre de Sir, semble entretenir l’attachement des Anglais envers leur élite. Une reconnaissance reproduite en Amérique du Nord par le titre de millionnaire.
Rapidement après la fondation de la Nouvelle-France, les colons ensauvagés prennent le nom de Canadien. Depuis la fondation de la Nouvelle-France, l’Église catholique lutte contre l’ensauvagement des Canadiens d’origine. Après la Conquête, l’Église catholique fera alliance avec la monarchie britannique. L’élite française étant retournée en France, seuls les Canadiens d’origine demeurent au pays. L’Église catholique s’opposera aux idéaux démocratiques du Parti Canadien, puis du Parti Patriote représentant les Canadiens d’origine à l’Assemblée Nationale de l’époque. Ce n’est qu’après la répression violente de la Rébellion des Patriotes que les Canadiens d’origine se réfugient dans l’Église catholique. L’Église catholique fera du Québec une sorte de vaste pensionnant...francophone. Les pensionnats autochtones seront principalement catholiques, car l’Église catholique convertissait les autochtones, tandis que les colons protestants justifiaient leur élimination par le mythe religieux de la Destinée manifeste.
Notons que les Anglais du Canada ne commenceront à se nommer Canadiens seulement après la Première Guerre mondiale, suite à l’arrivée d’immigrants italiens, grecs ou polonais. Dans la perception du monde des Anglais du Canada, l’idée du multiculturalisme imposé par Pierre Elliot Trudeau dans les années 1960 se glisse comme un gant sur leur valeur ancestrale.
La bienveillance humaine naturelle exprimée dans les cultures autochtones sera anéantie par la puissance des religions des vieux continents prétendant combattre le Mal. Un combat contre le Mal servant les élites en aveuglant les communautés avec des croyances contre nature. Un monde basé sur les croyances individuelles au détriment du savoir scientifique servant la collectivité. Aujourd’hui, pour ces élites le Mal en Amérique du Nord est la laïcité de l’État au Québec.
Toutefois, la vérité est dans la Nature, celle-ci révèle la surexploitation de l’environnement par la détérioration de notre milieu de vie. La Nature ne ment jamais : les changements climatiques représentent une réaction à la surexploitation de l’environnement et à une pollution persistante; la Nature répond aux mauvaises conditions de vie humaine par les pandémies. À court terme la violence et les mensonges triomphent de l’honnêteté et de la bienveillance, mais à long terme la nature de notre univers terrestre l’emporte sur l’abus de l’environnement, même avec les mensonges les plus divins. Étant donné la complexité de nos sociétés, les agressions contre la Nature peuvent tarder à se manifester dans les noyaux centraux de notre économie planétaire. Mais lorsqu’elles se manifestent, les effets en sont terribles et souvent irréversibles. Plusieurs anciennes civilisations régionales en témoignent.
Si le développement économique anglo-américain est le fruit d’une Destinée manifeste, il ne peut s’agir d’une volonté divine, mais plutôt d’une malveillance divine. Une telle malveillance s’accommode mal de la bienveillance humaine des peuples autochtones et des premiers colons francophones. La saga des Francophones d’Amérique démontre qu’un autre monde est possible. Ainsi, ils représentent le Mal pour l’élite dominante et ses complices religieux.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] 500 nations : L’histoire vue par les indiens d’Amérique, documentaire En ligne 30 juin 2020 : http://openyoureyes.over-blog.ch/-500-nations-l-histoire-vue-par-les-indiens-d-amérique-docs-vf
[2] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p265
[3] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[4] Chefs amérindiens – partie 4 – Black Haw https://www.youtube.com/watch?v=W3ORKzzDiLs en ligne 12 septembre 2020
[5] Histoire de la Nouvelle-France, par Charlevoix, vol. II, p. 345.
[6] Alexis de Tocqueville, "De la démocratie en Amérique" (1831)
© Bastien Guérard, 2021
Au XIXe siècle, la révolution industrielle bat son plein aux États-Unis. La puissance économique du Nord réclame une main-d’œuvre bon marché et des consommateurs pour l’écoulement de sa production manufacturière. Lorsque Lincoln propose l’abolition de l’esclavage, les États du Sud s’opposent à ce changement de modèle économique qui les a si bien enrichis. Toutefois, pour les gens du Nord du pays, le modèle économique d’exploitation des personnes doit s’adapter aux nouvelles technologies pour poursuivre l’accumulation du capital. L’organisation du capital s’adapte toujours aux nouveaux courants sociaux et technologiques pour mieux exploiter les gens : aujourd’hui, la forme moderne d’exploitation humaine repose sur la société de consommation fonctionnant au crédit bancaire.
Dans la foulée de l’accord de droits égaux consentis aux Noirs des États-Unis, la Constitution du pays est modifiée pour les protéger. Le 14e amendement est adopté pour renforcer le droit des personnes en assurant qu’aucune loi du pays « ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière. »[1] Toutefois, cet amendement servira également aux corporations. À l’origine, le principe de la corporation consiste à regrouper lecapital dans une entité au service du bien public pour un mandat de durée limitée, garantissant un retour sur l’investissement. Après la mise en vigueur du 14e amendement, la Cour suprême des États-Unis accepte la plaidoirie des avocats considérant les entreprises comme des personnes morales. La corporation en tant que personne moraleacquiert des droits égaux à ceux des personnes. En contrepartie, elle donne des responsabilités limitées aux investisseurs dans une compagnie à charte constituée en personne morale. La nouvelle forme de compagnie agissant légalement comme une personne, peut acheter et vendre des propriétés, emprunter de l’argent, intenter des poursuites judiciaires.[2] Les entreprises sont devenues des personnes morales immortelles.
À l’instar de Dieu, cette expérience de gestion démontre que l’immortalité ne contribue aucunement à la moralité des actions des entreprises. Le seul but d’une corporation est de générer des profits sans état d’âme, même si elle porte le nom trompeur de personne morale. Cette nouvelle législation pour les entreprises financées par actions leur permet de devenir de gigantesques entités capitalistes. L’économie du grand capital immortel est née, elle sera la divinité du prochain siècle.
La Guerre de Sécession, connue pour être la première guerre du monde industriel, est le prélude au carnage de la Première Guerre mondiale. Au-delà des morts pour la liberté, ces guerres imposent un modèle économique créé dans le Nord des États-Unis. Ce modèle d’affaires repose sur l’exploitation mécanique des ressources naturelles pour une production manufacturière à grande échelle par des ouvriers consommateurs des produits manufacturés. Tout cela permet l’accumulation de capital. Ce nouveau modèle permet, par la mécanisation de l’économie, d’exploiter les ressources naturelles à grande échelle, et, par le markéting, de soumettre les masses à la consommation. Toutefois, le modèle ne convenait pas aux gens d’affaires du Sud du pays, ni à ceux qui au-delà des frontières des États-Unis, profitaient d’un modèle économique incluant l’esclavage pour générer du capital.
À l’époque, nous sommes dans les glorieuses années de l’ère victorienne où Londres est la capitale financière du monde. À son apogée, l’Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couche jamais grâce à ses colonies, voit dans son ancienne colonie de l’autre côté de l’Atlantique le présage de son crépuscule. La montée en puissance des États-Unis inquiète Londres qui estime que la division de cette nouvelle nation ne peut que lui être favorable. Bien que l’esclavage soit aboli en Angleterre depuis 1833, Londres appuie les sécessionnistes du Sud des États-Unis pour des raisons économiques : l’industrie manufacturière en pleine expansion en Angleterre s’approvisionne en coton dans le Sud des États-Unis.
Le Sud des États-Unis où s’établirent les premières colonies anglaises en Amérique a été colonisé par des anglicans. Par contre, au Nord les puritains avaient fondé la Nouvelle-Angleterre pour s’éloigner des chrétiens moins dévots qu’eux. À l’occasion de la Guerre de Sécession, les croyances religieuses instaurent une nouvelle dynamique aux États-Unis. Les anglicans du Sud avaient maintenu des relations avec l’Église de la couronne britannique. Au Canada, nous retrouvons des anglicans, descendants de loyalistes, s’y étant réfugiés après la Révolution américaine. Ainsi Montréal, métropole du pays, devient la plaque tournante du financement des Sudistes par les Britanniques. Ce soutien apporté aux Sudistes par les Anglais du Canada provoqua la colère des Nordistes. Pour cette raison, l’accord de réciprocité économique, une politique libre-échangiste signée pour dix ans en 1854, n’est pas reconduit par les États-Unis en 1864.[3]
La politique expansionniste des États-Unis inquiète les Anglais du Canada. La Conquête de l’Ouest menace les possessions britanniques dans cette région du continent. La fin de la Guerre de Sécession accélère la construction d’un chemin de fer transcontinental pour joindre la puissance industrielle de l’Est aux ressources de l’Ouest. Étant donné l’effondrement du commerce Nord-Sud, la survie du Dominion du Canada exige la constitution d’un marché Est-Ouest pour assurer le contrôle du développement commercial de l’Ouest. La construction d’un chemin de fer transcontinental pour unifier ce marché Est-Ouest demande un apport colossal de capitaux que les provinces ne peuvent assumer seules. La fédération est réalisée pour créer un marché exclusif pour une élite anglaise vivant au Nord des États-Unis. À l’instar des États-Unis, la construction du chemin de fer canadien est marquée par de grandioses histoires de corruption.
L’Amérique du Nord en 1867
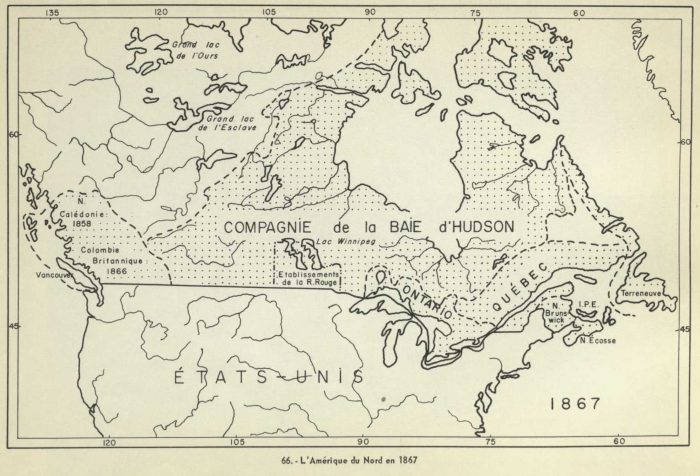
La nouvelle organisation politico-économique qu’est la Confédération veut protéger les intérêts britanniques des sautes d’humeur des États-Unis. Toutefois, la Confédération marque le détachement de l’élite anglaise du Canada de sa mère patrie pour se fondre tranquillement dans la culture anglo-américaine. L’élite anglophone du pays en supportant les états esclavagistes du Sud pendant la Guerre de Sécession, réunifie l’histoire de l’ensemble des Anglophones d’Amérique: en effet, pour cette élite, la fondation de la Confédération canadienne représente l’épilogue de la Guerre de Sécession. Officiellement au Canada, la construction du chemin de fer transcanadien accompagne le mythe de deux peuples fondateurs, francophone et anglophone. Propagé par l’élite anglophone du Canada, il escamote son support aux esclavagistes du Sud qui demeure l’une des raisons profondes ayant conduit à la fondation du pays. Le Canada ne se distingue des États-Unis que par une plus grande influence de la culture francophone d’Amérique.
À l’origine, la fédération comprend les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec (Bas-Canada) et de l’Ontario (Haut-Canada). À la simple demande des représentants de l’élite de ses colonies, Londres adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en 1867. La population du Québec officialise la Confédération à la suite d’une mascarade d’élections : « Cette double élection de 1867, la première dans le cadre de la toute nouvelle Confédération, est une des pires en matière de corruption. »[4] Le personnel d’élection sous le contrôle du parti conservateur de Macdonald rejette des votes de paroisses opposées à la Confédération pour des motifs bidons. Au Québec, dans 20 des 65 circonscriptions, le candidat conservateur est élu sans opposition : soit les adversaires avaient été séquestrés, les empêchant de se présenter lors de la mise en candidature; le candidat avait été encouragé à se désister pour de l’argent ou découragé sous la pression du clergé catholique.[5]
L’Église catholique joue un grand rôle dans l’adhésion du Québec, tout comme celle des Acadiens, à la fédération canadienne. « L'évêque Langevin insiste sur l'équation fédération-volonté́ de Dieu: « Vous la respecterez donc, Nos Chers Frères, cette nouvelle Constitution qui vous est donnée, comme l'expression de la volonté́ suprême du Législateur, de l'Autorité́ légitime et par conséquent de celle de Dieu même. »[6]
Au Québec, la fédération canadienne est présentée par l’Église comme une fatalité divine bien que la population francophone voie son espace de vie se dissoudre dans une mer d’anglophone. Wilfrid Laurier, un libéral partageant les idées des Lumières et qui deviendra en 1896 le premier francophone Premier ministre du Canada, s’opposera à l’Église catholique au sujet de la fédération canadienne : « elle qualifie la fédération de « salut du peuple » alors que Wilfrid Laurier la qualifie de « tombeau des Canadiens français ».[7] Comme bien des francophones, il apprend à mettre de l’eau dans son vin pour faire avancer sa cause. Bien que les Québécois voient leur poids dans la fédération diminuer constamment, des hommes politiques comme Laurier pourront se glisser jusqu’au pouvoir à force de compromis pour poser quelques jalons législatifs pouvant conduire à une plus grande justice sociale.
Le modèle politique canadien s’inspire de la mère patrie anglaise. Les institutions démocratiques britanniques s’implantent doucement au fur et à mesure que les Anglais parviennent à former la majorité des électeurs. Le Haut-Canada, correspondant à l’Ontario actuel, fut créé à partir de la Province of Quebec lorsque les Anglais devinrent majoritaires dans cette région. La fédération mise en place lorsque les Anglais devinrent majoritaires dans l’ensemble du territoire canadien. À l’image de l’Angleterre, les Anglais du Canada sont dirigés par une élite guidant les masses obéissantes à une solidarité ethnique dans l’espoir d’être anoblie. La nomination à vie au Sénat canadien est le vestige d’un pouvoir réservé à l’aristocratie du pays. Un relent de féodalisme demeure toujours présent dans l’esprit anglais.
La démocratie anglaise a pour origine la protection des privilèges des Lords ; « les « libertés britanniques » ont été l’apanage d’une petite minorité, les nobles surtout. »[8] La Magna Carta à l’origine du droit britannique vise à protéger le droit des barons qui au cours des siècles s’étendra au droit des plus nantis. La liberté démocratique de légiférer est soumise à l’approbation de la Chambre Haute (Chambre des Lords ou Sénat). Le système démocratique canadien copie ce système qui favorise la classe dominante. Depuis la Conquête, avec l’appui de Londres, l’objectif de la classe dominante anglo-saxonne est de faire du Canada un pays aussi britannique que l’Angleterre. Le Sénat canadien représente la Chambre des Lords où les titres de sénateurs sont attribués à de loyaux serviteurs de ce système socioéconomique favorisant les plus riches.
Comme la construction du chemin de fer devient la priorité de la fédération canadienne, elle sera à l’image de la naissance du pays, à savoir propice à la corruption. Le premier gouvernement canadien tombe, victime d’un scandale de corruption. Aujourd’hui, plusieurs Canadiens désavouent la mémoire accordée à Macdonald non seulement à cause de sa corruption, mais surtout pour son traitement inexcusable des peuples autochtones et des francophones. Le terminus du chemin de fer transcanadien conduit à la fondation d’une nouvelle province au nom reflétant l’esprit innovateur anglais : la Colombie-Britannique.
Dans l’esprit européen, une nation doit institutionnaliser sa présence dans un territoire conquis pour que les autres nations reconnaissent son contrôle sur ce territoire. Ainsi, l’établissement d’une représentation politique sur la côte Ouest du Canada au nord des États-Unis se veut une démonstration de puissance de la toute nouvelle fédération canadienne : de cette façon, elle institutionnalise sa présence et son contrôle de territoires sauvages. En 1871, la Colombie-Britannique accepte d’entrer dans la fédération canadienne à une condition : la construction d’un chemin de fer. Sa capitale sur l’île de Vancouver portera le nom de la reine de l’époque : Victoria.
La ville de Victoria, un ancien poste de traite fondé en 1843, devient la capitale de cette nouvelle province. Son origine remonte aux temps où la Compagnie de la Baie d’Hudson perdit ses droits de traite sur le territoire de l’Oregon après son intégration aux États-Unis. Responsable de fort Vancouver en Oregon, Jean-Baptiste McLoughlin envoya son adjoint James Douglas ouvrir un poste de traite sur l’île de Vancouver. James Douglas est un mulâtre des Antilles, fils d’un propriétaire de plantation écossais et d’une esclave. Son père, reconnaissant, le fit éduquer en Angleterre, mais lui trouva un travail de commis pour la Compagnie de la Baie d’Hudson dans les fins fonds de l’Amérique du Nord. Arrivé à 16 ans à Fort William, Jean-Baptiste McLoughlin le prit sous son aile, le considérant comme un fils; plus tard, il le fit venir à fort Vancouver : « Douglas devient son comptable attitré, puis son adjoint, avant d’occuper une place prépondérante dans le gouvernement provisoire de l’Oregon. »[9]James Douglas ouvre le poste de traite sur l’île de Vancouver qui deviendra la capitale de la province. Il demeure une figure emblématique de la fondation de la Colombie-Britannique, tout comme Jean-Baptiste McLoughlin l’est pour l’Oregon. Les deux personnages, l’un mulâtre des Antilles, l’autre plutôt Canadien d’origine, symbolisent dans le mythe nord-américain l’ouverture d’esprit anglais à l’origine de grands pays portant le rêve américain de liberté. Dans les faits, cette ouverture d’esprit n’avait d’Anglaise que les noms de famille : les activités socio-économiques locales se déroulaient en français. Les deux hommes sont devenus des figures légendaires en Amérique du Nord parce qu’ils ont embrassé la culture des Canadiens d’origine, la culture francophone d’Amérique. Comme plusieurs francophones ayant ouvert l’Amérique à la colonisation, les deux ont épousé des femmes métisses.
Avec la Confédération de 1867 faisant suite au Canada-Uni de 1840, le Québec devient une grosse réserve dominée par l’Église catholique, dans le Dominion du Canada britannique. Une sorte de pensionnat géant pour effacer les racines des Canadiens d’origine et son esprit d’ouverture pour en faire de bons Canadiens français respectueux de la Couronne britannique. La mainmise de l’Église sur les francophones du pays persiste jusqu’à la Révolution tranquille des années 1960. L’Église maintient son pouvoir sur les francophones en les soumettant aux préceptes du Petit catéchisme, et en cultivant l’ignorance et l’isolement, loin des idées démocratiques du monde des Lumières. Ces 120 ans de domination de l’Église catholique sont le legs des Anglais aux francophones, en réponse aux revendications démocratiques des Patriotes et à leur promotion de droits égaux pour tous. Les droits égaux, que Papineau avait déjà accordés aux Juifs, furent le legs du parti Patriote au pays.
Par réaction, la volonté de faire de la Nouvelle-France une colonie catholique provoquera la naissance d’un Québec laïc lors de la Révolution Tranquille. L’ensemble de la population francophone étant alors catholique, elle a facilement pu rejeter une religion qui intervenait dans toutes les sphères de la société. Un tel consensus social est impossible dans l’Amérique anglophone inondée d’un ensemble de croyances multiples. Aux États-Unis où les cultes religieux se confrontent pour l’influence de la politique, l’exclusion du divin serait une hérésie envers le mythe de la Destinée manifeste. La perte du divin réduirait l’acceptation sociale d’un système économique capitaliste au service d’une personne morale immortelle surexploitant la vie sur la planète. Aujourd’hui, au Québec la loi sur la laïcité de l’État représente un péché diabolique aux yeux de la culture dominante anglo-américaine, cette sirène de la société de consommation. Paradoxalement, avant de reprocher aux Québécois d’être trop laïques, les Anglais leur avaient reproché d’être trop catholiques. Pourtant, la religion catholique a joué un rôle fondamental dans la fondation du Canada.
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique constituant le Canada n’en fait pas un état pleinement indépendant. Jusqu’en 1931, il déprendra de Londres pour la signature de traités internationaux ou pour déclarer la guerre. Le nouveau pays compte 3,5 millions d’habitants, dont 1,2 million au Québec.[10] Le Canada n’adopte son propre drapeau national qu’en 1965, 12 ans après le Québec.[11] En 1982, le Canada renouvelle sa constitution soi-disant pour faire une plus grande place au Québec, mais aucun gouvernement du Québec ne l’a approuvée depuis. Le Québec demeure inféodé au système économique canadien.
À l’instar des États-Unis, les grandes entreprises de chemin de fer jouissent de privilèges pour unifier le pays grâce à une voie de transport moderne. La corruption politique endémique facilite le développement de grandes corporations qui exploitent au maximum les ressources naturelles et humaines. Dans nos sociétés, le pouvoir de ces personnes morales immortelles s’installe en maximisant l’accumulation du capital dans un système financier orientant nos vies. Une mécanique pyramidale froidement capitaliste, soutenant les privilèges d’une élite, prend forme en niant certaines réalités terrestres. La démocratie ne tempère que les abus du système qu’un pouvoir financier n’a pu voiler des lumières de la connaissance.
Malgré la majorité anglaise aux pays, les jeux électoraux placent à l’occasion un francophone à la tête du gouvernement canadien au grand désarroi des anglophones. Déjà en 1900, lorsque le Canada place à sa tête Wilfrid Laurier, le premier Premier ministre francophone du pays, le Toronto News souligne le problème profond du pays : « Il est infiniment déplorable que le Gouvernement demeure au pouvoir grâce au vote massif d’une section du peuple canadien parlant une langue étrangère et défendant un idéal étranger à la race dominante de ce pays. »[12] Depuis la fondation du pays, les politiciens canadiens, avec le succès que l’on connait, tentent de résoudre ce problème.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1]https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatorzi%C3%A8me_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis en ligne 14 janvier 2021
[2] Mark Achbar & Jennifer Abbot, The Corporation, documentaire, 2003, 145 min
[3] Bédard, Éric, Histoire du Québec pour les nuls, First édition, 2012, p150
[4] https://www.ledevoir.com/politique/canada/565265/histoire-la-corruption-des-premieres-elections-en-1867 en ligne 14 janvier 2021
[5] https://www.ledevoir.com/politique/canada/565265/histoire-la-corruption-des-premieres-elections-en-1867 en ligne 14 janvier 2021
[6] https://quebec.huffingtonpost.ca/normand-rousseau/les-quebecois-l-glise-et-la-federation_a_23078436/ en ligne 14 janvier 2021
[7] https://quebec.huffingtonpost.ca/normand-rousseau/les-quebecois-l-glise-et-la-federation_a_23078436/ en ligne 14 janvier 2021
[8] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p55
[9] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p291
[10] Bédard, Éric, Histoire du Québec pour les nuls, First édition, 2012, p159
[11] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p182
[12] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p201
© Bastien Guérard, 2021
La documentation indique clairement que la répression de 1837-38 contre le mouvement démocratique des Patriotes pousse nombre d’entre eux à l’exil. Tant les Canadiens d’origine que les Métis prennent la route vers l’Ouest suivant ceux qui les ont précédés en faisant la traite de la fourrure. Ils portent avec eux l’espoir d’un monde meilleur, plus libre et plus juste :
« Nous savons par exemple que François-Xavier Mathieu trouve refuge à la Rivière Rouge, puis en Oregon, où nous retrouvons des communautés « françaises » décrites par De Monfras comme étant habitées par des « Bois-Brûlés », forgeant leurs politiques autour du concept de « gouvernement responsable » pour former des gouvernements provisoires; des concepts que nous savons populaires au Bas-Canada et à la Rivière Rouge. »[1]
À travers le commerce de fourrure, un réseau d’idée et de fraternité a pris racine. Les idéaux des francophones d’Amérique que le père Charlevoix a rapportés en Europe, qui inspirèrent les épopées révolutionnaires de l’époque des Lumières, sont toujours présents dans l’Ouest du continent nord-américain au XIXe siècle : un monde aux frontières indéterminées. Dans ce monde aux frontières des empires coloniaux, de nouvelles organisations sociales se développent à la marge du système dominant.
Déjà à l’époque de la Rébellion des Patriotes, les habitants de la Rivière Rouge suivent avec intérêt les évènements au Bas-Canada. Ils placent tant d’espoir dans le succès de ce mouvement qu’ils créent des chansons patriotiques faisant l’éloge de Papineau. « Dans les plaines, les Métis fabriquèrent un drapeau, appelé́ le Papineau standard, qui fut agité en triomphe pendant des années, et les actes des rebelles étaient exaltés aux cieux. »[2] Les idées ayant inspiré l’époque des Lumières en Europe et ses mouvements libérations à travers le monde demeure bien vivante dans l’Ouest de l’Amérique auprès des peuples pouvant encore subsister en harmonie avec la Nature.
Dans l’Ouest du continent, l’arrivée du chemin de fer impose le modèle économique anglo-américain conduisant à la dépendance envers un système de consommation. Un modèle économique similaire s’installe de part et d’autre d’une ligne imaginaire définissant la frontière entre la monarchie parlementaire canadienne et la république des États-Unis. La grande distinction entre le système économique du Canada et son voisin du Sud est son approche sociale plus bienveillante.
Deux ans après la confédération, en 1869, le Canada rachète les droits de la Compagnie de la Baie d’Hudson sur le territoire de la couronne. Le nouveau pays décide d’envoyer des arpenteurs dans la région de la rivière Rouge au Manitoba pour planifier la colonisation des terres. « À la demande de ses compatriotes, Riel forme un gouvernement provisoire dont le mandat est de négocier l’exercice des droits territoriaux des Métis. »[3] Les Métis aspirent à la création d’une province à leur image. La volonté des Métis de former une province dans le Canada incarne le mieux, le Rêve de Champlain et les idées inspirant l’époque des Lumières : ils souhaitent s’établir comme peuple dans le concert des nations.
Louis Riel est descendant de Marie-Anne Gaboury, première femme québécoise à se rendre dans l’Ouest. En 1804, à 24 ans, elle décide d’accompagner son mari trappeur indépendant dans l’Ouest, Jean-Baptiste Lagimodière. Mère de dix enfants, « grande pionnière, Marie-Anne Gaboury a donné naissance au premier enfant blanc légitime au Manitoba, au premier enfant blanc légitime en Saskatchewan et au premier enfant blanc légitime en Alberta. Les Indiens saulteux l’appelaient Ningah, qui veut dire mère. »[4] Sa fille Julie est la mère de Louis Riel.
Jeune, Louis Riel est remarqué par les Sulpiciens qui l’envoient à Montréal pour faire ses études au Collège de Montréal, puis au Mont Saint-Louis. La mort de son père en 1864 le détourne de la vocation religieuse. Puis l’annulation de ses fiançailles avec une Québécoise pure laine suite au désaccord avec sa famille l’incite à retourner dans l’Ouest. L’influence de l’idéologie pure laine protégeant la pureté de la race commence à diviser d’anciens alliés.
Dans l’Ouest, les Métis choisissent Louis Riel comme porte-parole pour la réputation de sa famille et ses connaissances en droit. Devant l’action des arpenteurs, Louis Riel prend le gouvernement fédéral de vitesse. Sous la supervision du représentant en chef de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Donald Smith, futur Lord Strathcona, Riel organise un congrès. Une quarantaine de représentants sont élus, moitié francophones, moitié anglophones qui entérinent le gouvernement provisoire.[5] « L’équipe d’arpenteurs est expulsée et Riel fait parvenir une charte des droits à Ottawa. » [6] Le gouvernement provisoire de Louis Riel négocie l’entrée de la province du Manitoba dans la Confédération canadienne le 15 juillet 1870. Le Manitoba est officiellement une province bilingue « où les droits des Métis francophones sont reconnus, à son corps défendant, par le gouvernement du dominion, alors dirigé par John A. Macdonald. »[7] Les Métis obtiennent 1 400 000 acres de terres du gouvernement fédéral pour l’ensemble du Manitoba, qui représente 160 000 000 d’acres. Toutefois, ils n’obtiennent pas l’amnistie pour les membres du gouvernement provisoire, dont Louis Riel.
Louis Riel, vers 1880

L’initiative du gouvernement provisoire de Riel avait soulevé la « colère des ‘expansionnistes’ canadians, une poignée d’orangiste fanatique qui détestent tout ce qui est Indien, Métis, francophone et catholique. »[8] Le groupe d’orangiste anglo-ontarien dirigé par John C. Schultz organise une résistance armée contre le gouvernement provisoire de Louis Riel. De passage sur la rivière Rouge, ils se font arrêter par les Métis. Le groupe au caractère belliqueux est conduit en cour martiale, jugé et condamné à mort, puis immédiatement gracié. Thomas Scott, un homme malhonnête au passé criminel, considère cette décision comme une faiblesse de la part des Métis. Après plusieurs altercations avec ses gardes, il est jugé de nouveau pour insubordination et fusillé. Cette exécution ne convient pas à l’ordre britannique dominant le pays. Louis Riel est considéré responsable de l’exécution de Thomas Scott, bien que ce soit dans le cadre de procédures judiciaires légales qu’il fut condamné. Sa tête est mise à prix par le gouvernement libéral de l’Ontario : avec 5 000 $ en récompense, les fameux chasseurs de primes de l’Ouest sauvages se lancent à la poursuite de Louis Riel.
À l’époque, le Manitoba compte 12 000 habitants, parmi lesquelles se retrouvent 1 500 colons anglo-ontariens. La conquête de l’Ouest du continent anime également les colons loyalistes de l’Ontario : « Cédant sous la pression des membres de l’ordre des orangistes créé en Ontario pour célébrer la victoire de Guillaume d’Orange sur les catholiques d’Irlande au XVIIe, Ottawa envoie des troupes dans l’Ouest, suivies par des miliciens protestants voulant en découdre avec Riel. »[9] Selon le lieutenant-gouverneur Adam G. Archibald, la présence de troupe militaire du nouveau régime canadien donne une certaine protection à « cette petite bande d’hommes désordonnés et désœuvrés qui infestent les tavernes de Winnipeg. »[10] Dans un rapport au Premier ministre Macdonald, du 8 octobre 1871, le lieutenant-gouverneur Archibald indique qu’« un grand nombre de Métis français ont été tellement battus et outragés par une section du peuple, petite mais tapageuse, qu’ils ont l’impression de vivre dans un état d’esclavage. »[11]
Le meurtre d’Elzéar Goulet par deux membres de l’Ontario Rifles, une loge orangiste, demeure sans conséquence pour les agresseurs. « Elzéar Goulet a été lapidé et noyé à l’instigation de John C. Schultz, selon les Métis qui le tiennent aussi responsable de la mort de plusieurs autres des leurs. »[12] Les conséquences pour John C. Schultz, ce meneur d’Orangiste notoire, seront d’être nommé au Sénat, avant de devenir le lieutenant-gouverneur du Manitoba de 1888 à 1895. Cette nomination illustre comment le mouvement orangiste fait son nid au Canada.
Louis Riel fuit dans le Dakota du Nord avant l’arrivée de l’armée canadienne. Louis Riel sera jugé par contumace en 1875 ; « il est amnistié à la condition de ne pas revenir au pays avant cinq ans. »[13] Le jugement confirme que l’exécution de Scott a été un acte d’un gouvernement reconnu par les autorités canadiennes et impériales.[14]
En dépit de cette condamnation injuste, et à la demande du lieutenant-gouverneur Archibald, Louis Riel démontre toujours sa loyauté en constituant un bataillon de 300 cavaliers métis pour défendre le Canada contre les raids des Fenians provenant du Minnesota. Les Fenians sont des Irlandais américains en lutte pour l’indépendance de l’Irlande qui s’attaque aux intérêts britanniques. Après la guerre des Sécessions aux États-Unis, des Irlandais Fenians basés au Minnesota firent des raids au Canada. La milice métisse recrutée par Louis Riel défendit le territoire canadien contre les Fenians irlandais. Malgré cela Riel demeura un paria dans son pays.
Lorsque Riel est élu comme député fédéral de la circonscription de Provencher en 1873, il se présente à Ottawa déguisé pour aller signer le registre des députés. Le gouvernement de l’Ontario sans tenir compte de l’amnistie du gouvernement fédéral, maintien toujours sa récompense pour sa capture.[15] Lorsqu’il est dans la région d’Ottawa, Riel trouve refuge au Québec auprès des Métis de la rivière du Lièvre et de la rivière Gatineau.[16] Cette situation est à rendre fou; lié par les droits constitutionnels britanniques; jumelé à la pression psychologique qu’exerce sur lui l’avenir des Métis et des peuples autochtones de l’Ouest; cet homme éduqué par des religieux catholiques devient fragile mentalement. Louis Riel est au cœur de la croisée des divers mondes en mutation de l’époque. Divers univers catholiques, autochtones, francophones, jusqu’au droit britannique devaient s’affronter et se confondre dans la tête de Louis Riel.
Des conceptions du monde se bousculent en Amérique en cette fin de XIXe siècle. Les Amérindiens de l’Ouest, désemparé par l’extermination des bisons, signent une série de traités avec le gouvernement fédéral du Canada où ils cèdent l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, en échange « des terres de réserves, des annuités, un versement annuel pour l’achat de munitions, une allocation de scolarité et l’accès aux soins médicaux. »[17] Les terres réservées au Métis sont distribuées par l’autorité fédérale sous forme de bons négociables, des scripts : « Aussitôt ces scripts délivrés, des hordes de spéculateurs ontariens les rachètent à bas prix à leurs propriétaires. »[18]
Avec l’arrivée des Orangistes d’Ontario, la situation à Winnipeg n’est pas invitante à l’établissement d’une famille non anglophone. Le chemin de fer du Canadien Pacifique est en construction emmenant alcools, maladies et prostitutions dans la région. La spéculation foncière atteint des sommets, « un terrain se vend plus cher à Winnipeg qu’à Chicago. »[19] Plusieurs Métis décident de partir pour échapper à un mode de vie imposé par les colonisateurs anglo-saxons. Qu’ils soient Métis ou Autochtones, « comme avec les Canadiens français, on cherche à les éliminer en employant une stratégie de violence étatique larvée, sous couvert de légalité. »[20]
Malgré les nombreux scandales de corruption qui firent tomber le gouvernement de Macdonald en 1873, la construction du chemin de fer transcanadien se poursuit en Saskatchewan en 1884. Le changement du trajet prévu sème le mécontentement tant chez les colons anglais que chez les Métis et les autochtones. À Batoche, en juillet 1884, Riel rencontre les deux groupes auxquels il propose de soumettre une pétition à Ottawa. La proposition est acceptée. « Le 16 décembre 1884, la pétition qui comprend vingt-cinq articles touchant les droits fonciers et la représentation politique est envoyée à Ottawa. »[21] Le 15 mars 1885, Lawrence Clarke, un fonctionnaire fédéral, se présente à Batoche disant que cinq cents membres de la Police montée sont en route pour arrêter Riel. « C’est faux, mais aussitôt c’est le branle-bas de combat, la communauté s’arme et Riel ordonne à ses hommes de réquisitionner les magasins des alentours. »[22] Le soir même Riel se proclame président d’un gouvernement provisoire et s’adjoint Gabriel Dumont comme général.
Un premier affrontement entre la Police montée appuyé par des volontaires anglais contre les troupes de Riel a lieu le 26 mars 1885 à l’initiative du surintendant de la Police montée. La nouvelle se diffuse comme une trainer de poudre en flamme dans l’Est du pays où « des dizaines de volontaires affluent dans les casernes de la milice pour aller combattre les Sauvages dans les contrées lointaines de l’Ouest. »[23] Cette nouvelle rébellion de Riel sert très bien les intérêts du Premier ministre Macdonald; elle permet de se débarrasser de Louis Riel, cet encombrant démocrate du siècle des Lumières en plus d’obtenir du financement pour terminer le chemin de fer transcontinental toujours en difficultés financières. En résumé, la nouvelle rébellion justifie la demande de nouveaux crédits au gouvernement fédéral.
À Montréal, le directeur du Canadien Pacifiquc Railways, Cornelius Van Horne, offre de transporter gratuitement les troupes vers l’Ouest. Un coup de pub démontrant l’utilité de la construction du chemin de fer, tout en justifiant l’injection de nouveau fonds public dans cette entreprise privée. Un officier britannique d’expérience prend la tête de la milice canadienne, le major général Frederick Middleton. Un homme de grande réputation dans la répression coloniale pour avoir affronté les Maoris en Nouvelle-Zélande et les Santhal en Inde.[24] Les troupes sont également accompagnées d’un des premiers représentants du complexe militaro-industriel américain en développement, le capitaine Howard de la Garde nationale du Connecticut. « Il a été dépêché par le fabricant de la Gatling gun, la première mitrailleuse opérationnelle, celui-ci étant désireux de la tester sur le terrain. »[25] Les Métis seront les cobayes pour démontrer l’efficacité de la technologie industrielle à la guerre et la facilité de manipulation des masses populaires par les médias : une matrice du mode de développement à l’anglo-américaine annonçant les horreurs du XXe siècle à travers le monde.
La bataille de Batoche a lieu du 8 au 12 mai 1885 où le petit groupe de Riel sera écrasé par la milice canadienne-anglaise. Comme à l’habitude des avancés des civilisations guerrières, les pillages et la dévastation des habitations suivent l’affrontement. « Il est considéré comme étant de bonne guerre de dépouiller tout ce qui n’est pas Blanc, protestant et Anglais. » Les villages avoisinants de Clarke’s Crossing, l’Anse-aux-Poissons et Battleford subissent également le pillage et la destruction. Même le général britannique Middleton sera poursuivi pour vol de fourrure d’une valeur de 5 634 dollars à un Métis du nom de Charles Bremner. Ce dernier obtiendra compensation par le gouvernement Laurier en 1899. Dumont fuit aux États-Unis, ce virtuose de la Winchester terminera comme tireur d’élite pour le Buffalo Bill Wild West Circus.
Tandis que Riel se rend à des éclaireurs du général Middleton pour s’assurer de la survie de sa famille en échange de sa reddition.
Revenu pour défendre les droits des Métis de Saskatchewan, trahis par le gouvernement canadien, Riel sera capturé, jugé et pendu au nom du développement de la civilisation anglaise en Amérique. Cinquante mille personnes manifestent à Montréal contre la pendaison de Louis Riel où des orateurs comme Honoré Mercier et Wilfrid Laurier prendront la parole pour dénoncer l’assassinat judiciaire de Louis Riel par le guet-apens qui lui a été tendu. Le Premier ministre Macdonald maintient la condamnation à mort, en rétorquant de façon cinglante aux Québécois : « Riel sera pendu, même si tous les chiens aboient au Québec. »[26] Il démontre tout le respect de l’élite anglaise du pays envers l’un des deux peuples fondateurs.
La mort de Louis Riel coïncide, à quelques semaines près, à l’inauguration de la ligne transcontinentale du Canadien Pacific Railways, ce qui entraine une hausse des actions. Maintenant vice-président de l’entreprise, Cornelius Van Horne marque l’événement avec son humour anglais en proposant d’ériger un monument à la mémoire de Louis Riel.[27]
Le Canada bilingue est mort avec Louis Riel. Sa pendaison, en 1885, annule la possibilité de l’émergence d’une province francophone métisse dans l’Ouest. Cette mort symbolise la perte du rêve de Champlain, celui de voir un nouveau peuple émerger de la Grande Alliance des Français avec les Autochtones d’Amérique. Pour les journaux francophones de l’époque, quelle que soit son orientation politique tous soulignent le mépris des Anglais à leur encontre ; « désormais, la majorité anglaise n’entend plus permettre aucune revendication de la part de l’élément français. Elle fera arbitrairement régner l’injustice. […] L’on pourra impunément accumuler contre nous les provocations. »[28]
Le déclin de la francophonie canadienne est maintenant programmé dans la justice constitutionnelle britannique. Le discours d’Honoré Mercier au Champ-de-Mars devant 55 000 personnes, suite à la pendaison de Louis Riel est évocateur de la situation : « Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison; du fanatisme de Sir John et de quelques-uns de ses amis; de la trahison de trois des nôtres qui, pour garder leur portefeuille, ont vendu leur frère. » [29] Cette phrase illustre bien la situation dans lequel le Québec se retrouve à l’aube du XXe siècle devant la conquête de l’Ouest francophile.
En 1876, le gouvernement fédéral adopte l’Acte des Sauvages, permettant d’étendre son contrôle sur les Réverses : « Les conseils de bande ne pouvaient se réunir sans la présence d’un agent fédéral qui fixait l’ordre du jour et dirigeait les débats, tout en étant juge et poursuivant désigné par le ministre des Affaires indiennes. »[30] L’Acte des Sauvages stipule qu’aucune taxe ne peut être réclamée à un autochtone, ils deviennent les pupilles de l’État.
La protection des terres autochtones est un marché de dupe : la position paternaliste du gouvernement de la Couronne relativement aux territoires autochtones dont elle a pris le contrôle, se présente comme une protection vertueuse « en interposant le roi entre les indigènes et les forces du marché qui, en l’absence de contrôle, étaient susceptibles de miner leur titre de propriété. »[31] Dans les faits, en disant les protéger des lois du marché, cette procédure exclut les autochtones du marché, du commerce et de l’activité économique.
Suite à la vente de leur terre à bas prix en échange de rente vivrière, les autochtones sont regroupés dans des Réserves qui prennent la forme d’une propriété collective autochtone. Ce qui est conforme à la philosophie amérindienne, mais totalement dysfonctionnelle dans l’économie de marché en développement. Il est impossible pour un autochtone vivant en réserve d’emprunter de l’argent à la banque, car il n’a pas de résidence à mettre en garantie. Si l’autochtone veut vivre dans la nouvelle Amérique, il doit rompre avec ses traditions. L’expression de ses traditions demeure confinée dans des réserves, avant d’être interdite pour un certain temps.
Comment s’organiser socialement dans ses conditions où le fédéral est le seul pourvoyeur de revenu pour les peuples autochtones : le meilleur moyen de tuer un peuple est de l’empêcher de travailler. Les peuples autochtones et les peuples métis furent anéantis au profit de l’établissement du monde capitaliste actuel modifiant l’environnement pour son avantage exclusif. L’épopée de la conquête de l’Ouest, tout comme l’histoire de l’Amérique du Nord est racontée à l’avantage exclusif de l’élite anglaise.
Dans son ouvrage sur la disparition des Métis de l’Est du Canada, Pierre Montour identifie cinq éléments contribuant à l’effacement de ce peuple. L’alliance de l’Église catholique avec la couronne britannique pour briser la résistance autochtone afin d’imposer l’idéologie antagonisme européenne. Le second élément est l’abandon des Métis aux combats contre les troupes des États-Unis en 1813. Le troisième vient de tous les gouvernements canadiens qui en 1850 exproprient les indigènes. Le quatrième est l’Acte des Sauvages de 1876 lorsqu’Ottawa les prive de leurs droits ancestraux et leurs exemptions fiscales. Le cinquième élément est la pendaison de Louis Riel. [32]
Après avoir écrasé les métis francophones dans l’Ouest, il serait contreproductif pour le Canada anglais de reconnaître l’existence historique de Métis dans l’Est du pays : bien Riel se réfugiait au Québec auprès des Métis de la rivière du Lièvre et de la rivière Gatineau lors de ses passages à Ottawa.[33]
Cette position du Canada se conforme à une remarque du rapport du lieutenant-gouverneur Archibald d’octobre 1871, où il ajoute que les nouveaux colons de l’Ontario « semblent croire que les Métis français doivent être effacés de la face du globe. »[34] Aujourd’hui, les Métis francophones n’ont plus leur place dans l’histoire de la Confédération canadienne : « Ottawa a financé des groupes indigènes de l’Ontario et de l’ouest qui militaient en faveur d’une définition restrictive du Métis, limitée aux descendants d’une mythique nation métisse « historique » du Manitoba et du nord-ouest de l’Ontario à partir de 1816. »[35] Ainsi, le Ralliement national des Métis représentant les Métis de l’Ouest prend une position historique : « Les dirigeants du Ralliement considèrent Cuthbert Grant comme père fondateur de la nation métisse au Canada. »[36] Ainsi, d’après cet organisme vivant de subvention fédéral la nation Métis aurait été fondée par cet anglophone sur la rivière Rouge en 1816. La présence française dans la région, qui date d’une centaine d’années de plus, est sublimement retirée de l’histoire du Canada. L’histoire métis francophone est effacée au profit de métis anglophone, un peu comme le Canada bilingue.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Sébastien Malette, Guillaume Marcotte, La figure de Marie-Louise Riel en Outaouais : une réponse au néonationalisme métis, traduction abrégée de « Marie- Louise : Protector of Louis Riel in Québec. » Media Tropes, Vol XVII, No 1 (2017), 26-74.
[2] Sébastien Malette, Guillaume Marcotte, La figure de Marie-Louise Riel en Outaouais : une réponse au néonationalisme métis, traduction abrégée de « Marie- Louise : Protector of Louis Riel in Québec. » Media Tropes, Vol XVII, No 1 (2017), 26-74.
[3] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p148
[4] https://ici.radio-canada.ca/radio/profondeur/RemarquablesOublies/marieAnne_Gaboury.html
[5]Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p135
[6] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p148
[7] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p137
[8] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p133
[9] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p149
[10] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p137
[11] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p138
[12] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p138
[13] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p148
[14] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p140
[15] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p139
[16] Sébastien Malette, Guillaume Marcotte, La figure de Marie-Louise Riel en Outaouais : une réponse au néonationalisme métis, traduction abrégée de « Marie- Louise : Protector of Louis Riel in Québec. » Media Tropes, Vol XVII, No 1 (2017), 26-74.
[17] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p149
[18] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p142
[19] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p142
[20] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p142
[21] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p144
[22] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p145
[23] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p145
[24] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p146
[25] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p147
[26] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p158
[27] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p162
[28] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p158
[29] https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/96691/louis-riel-analyse-discours-honore-mercier
[30] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p158
[31] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p188
[32] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p133
[33] Sébastien Malette, Guillaume Marcotte, La figure de Marie-Louise Riel en Outaouais : une réponse au néonationalisme métis, traduction abrégée de « Marie- Louise : Protector of Louis Riel in Québec. » Media Tropes, Vol XVII, No 1 (2017), 26-74.
[34] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p138
[35] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p192
[36] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p180
© Bastien Guérard, 2021
Les Anglos-ontariens devenus majoritaires à la législature du Manitoba abolissent le français comme langue officielle dès 1879.[1] Cet événement malheureux est caractéristique des gouvernements anglophones en Amérique du Nord qui s’acharnent à détruire les francophones et le métissage culturel qu’il représente de la façon suivante, selon Norman Lester : « Les rêves des Indiens, ceux des Métis, ceux des Canadiens français catholiques, sont tous battus en brèche par le rouleau compresseur de la majorité anglophone qui n’a cure de cette diversité culturelle. »[2] Dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, des variantes de cette politique surgissent d’une région à l’autre. Les cultures métissées portées par les francophones à travers le continent subissent les assauts de la culture anglophone depuis l’aube de la colonisation.
Dans la vallée du Mississippi, le français disparaît lentement sous diverses pressions sociopolitiques résultant de la colonisation massive en provenance de l’Est. De plus, l’immigration en provenance de l’Europe à la poursuite du rêve américain de Liberté, envahit peu à peu le continent : les immigrés portent en eux la soif d’un idéal de liberté galvaudé par les écrits anglo-américains. Le rêve de s’enrichir sans compromis sous les valeurs de la démocratie américaine enthousiasme le monde entier.
Une autre Amérique, utilisant une multitude de langues, représentant autant de manières de voir le monde et de façons d’interagir avec son environnement, doit s’effacer au profit d’un monde bâtir sur la puissance technologique alimentée par l’accumulation de capital. Ce Nouveau Monde en évolution s’impose à son environnement grâce aux avancées technologiques soutenues par une science en effervescence. Dans un monde tourné vers les avancées de la civilisation, imposer aux Sauvages ce modèle incomparable de modernité et de liberté ne peut qu’être bienfaisant.
Le modèle culturel francophone en Amérique démontre la possibilité du métissage avec les Sauvages. Cette option remet en question l’unicité divine de la Destinée manifeste développée par les puritains de Nouvelle-Angleterre pour imposer un modèle socioéconomique justifiant l’injustice du modèle capitaliste. La possible comparaison de ce modèle socioéconomique conquérant avec un autre modèle de liberté économique promouvant la bienveillance, la tolérance et un partage plus équitable des ressources nuirait à son image. L’histoire des francophones en Amérique fraternisant avec les autochtones doit s’effacer au profit d’un mythe civilisationnel plus rentable pour l’élite capitaliste.
Bien que le français soit une langue phare de l’élite européenne depuis l’époque des Lumières, en plus d’être la langue d’usage commerciale dans l’Ouest de l’Amérique au début du XIXe siècle, cette langue est inappropriée pour l’image d’une nouvelle humanité projetée par l’élite anglo-américaine : l’unicité de cette Destinée manifeste proprement anglo-américaine se poursuit dans la colonisation de l’Ouest du continent.
En 1820, le sénateur Thomas Hart Benton, soucieux de la Destinée manifeste, repousse les frontières naturelles du pays au-delà des Rocheuses, jusqu’au Pacifique. Il est favorable au soutien de l’état au développement du chemin de fer et du télégraphe.[3] Cette culture hégémonique s’appropriera tout, au point de croire que Dieu est américain : caricaturalement la chanson God is an American devient un grand succès au XXe siècle.
Le développement à l’ère industrielle est relativement facile aux États-Unis. Le pays jouit de ressources abondantes, d’une immigration massive servant de main-d’œuvre bon marché; de plus, les villes se construisent autour des nouveaux chemins de fer. En Europe, les villes doivent être éventrées pour introduire le chemin de fer, rendant plus difficile la modernisation de l’économie. Vierges d’infrastructures humaines et pleines de ressources, les États-Unis représentent l’avenir : de grands industriels deviendront les ambassadeurs du développement : Vanderbilt pour le chemin de fer, Carnegie pour l’acier, Rockefeller pour le pétrole, Edison pour l’électricité. Les États-Unis deviennent le phare de la Révolution industrielle.
La France, compagne révolutionnaire de la démocratie moderne, offre aux États-Unis la Statue de la Liberté pour commémorer le centième anniversaire de la Révolution américaine. Une façon de passer le flambeau de l’épopée des Lumières à l’Amérique : la France indique à la face du monde que le rêve de liberté se passe maintenant en Amérique, dans cette Amérique anglophone. La France, en éblouissant le monde entier par ce cadeau représentant les Lumières du progrès, conforte les Anglo-américains et les futurs immigrants dans la justesse de leur cause. À l’entrée du port de New York, la Statue de la Liberté devient le phare du capitalisme moderne. Par ce cadeau, la France déclasse du même coup les francophones d’Amérique, qui n’auront plus qu’une place anecdotique dans l’histoire du monde.
François Mercier, célèbre voyageur canadien (1871)

En Amérique, pour la colonisation de l’esprit, le Francophone devient un parasite dans la formation d’une histoire nationale dogmatique, tant aux États-Unis qu’au Canada. Les francophones d’Amérique attachés à des valeurs plus traditionnelles, plus autochtones, plus bienveillantes, sont présentés comme des arriérées refusant le progrès. La francophonie d’Amérique, qu’elle soit d’origine française, métis ou autochtone, n’a plus sa place face à la folie colonisatrice de l’ère de la Révolution industrielle. L’époque balance dans un nouvel engouement pour la sélection naturelle où l’anglais devient la langue de la modernité.
Dans la lutte contre les Francophones de curieuses alliances se nouent : les Irlandais s’allient à des Orangistes anglais, un groupe pourtant constitué pour commémorer une victoire contre les Irlandais : « Orangistes et Irlandais poursuivaient un même but : écraser les Franco-Ontariens, les orangistes parce qu’ils étaient catholiques, les Irlandais parce qu’ils parlaient français. »[4] Un revirement surprenant de la part des Irlandais d’Amérique, car l’Irlande perdit l’usage de la langue celte suite à la conquête anglaise en 1541 : depuis ce temps, Orangistes anglais et Irlandais s’affrontent de l’autre côté de l’Atlantique, contrairement changement observé en Amérique.
La prise de position des Irlandais pour protéger la langue de leur conquérant a des incidences sur l’Église catholique au Canada. « L’Église de Rome fut souvent appelée à arbitrer ces conflits, mais elle s’est généralement rangée du côté des évêques irlandais qui considéraient que la pratique du catholicisme hors du Québec passait par l’usage de la langue anglaise. L’Église de Rome, pour qui tout nationalisme paraissait suspect, s’est toujours montrée conciliante à l’égard des assimilateurs anglo-canadiens. »[5] Partout en Amérique, l’Église de Rome est guidée par une volonté́ de préserver « ses investissements spirituels ».[6] L’immigration des Irlandais catholiques anglicisés favorise le soutien du Vatican à la communauté irlandaise plus apte à s’intégrer dans la société nord-américaine : « Les prêtres irlandais réclament l’usage commun de l’anglais pour résister à un éventuel développement du protestantisme. »[7]
Ne liant plus la langue à la foi, l’immigration irlandaise contribue à l’anglicisation de l’Église catholique sur l’ensemble du territoire nord-américain. « Dans un contexte qui dépasse les enjeux régionaux de la Louisiane, l’institution de l’Église s’avère tout de même un des vecteurs d’accélération de l’assimilation, à la différence de ce qui a pu être vécu au Canada français. »[8] En faisant de l’anglais l’expression de sa foi, la puissante Église de Rome sert l’anglicisation de l’Amérique: « Pour être un vrai Américain, on va laisser entendre qu’il faut parler anglais. »[9] La langue française n’étant plus la langue de l’économie, l’Église catholique abandonne les francophones d’Amérique.
Seule entité à avoir résisté au rouleau compresseur de la culture anglaise en Amérique, le Québec demeure une menace à l’hégémonie de la culture dominante du continent. Au Québec, l’Église catholique se présente comme un rempart à l’anglicisation, mais contribue à l’effacement de cette autre option du développement apparue en Nouvelle-France à travers l’alliance avec les autochtones. Cet autre monde de liberté bienveillant, porté par les Canadiens d’origine imprégnés de culture autochtone s’efface au nom des dogmes inculqués par la religion catholique. Les nations métissées, issues du contact des cultures francophone et autochtone en Amérique, disparaissent sous le coup de la religion catholique.
Pourtant, ces gens volontaires, ces peuples bienveillants ont démontré plus d’une fois leur intérêt à intégrer le Nouveau Monde naissant. La pendaison de Louis Riel démontre la fermeture sur les autres de la culture anglaise d’Amérique. La bienveillance n’a pas sa place dans le monde capitaliste, car elle est un facteur réduisant les profits, donc le pouvoir. Malgré tout, dans le contexte de la mondialisation anglophone, le Québec a réussi à préserver un peu de cet héritage autochtone de la francophonie d’Amérique. Avec plus de 70 % de la production mondiale d’eau d’érable, le Québec témoigne de l’héritage d’une vie en harmonie avec son environnement : un modèle économique sucre d’érable toujours dérangeant pour l’hégémonie du modèle économique sucre blanc.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p140
[2] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p406
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_chemins_de_fer_am%C3%A9ricains en ligne 20 janvier 2021
[4] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p203
[5] http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cnd_antifranco.htm
[6] Nadeau, Jean-François, L'Église a joué un rôle dans la disparition du français en Louisiane, Le Devoir, 22 mars 2018
[7] Nadeau, Jean-François, L'Église a joué un rôle dans la disparition du français en Louisiane, Le Devoir, 22 mars 2018
[8] Nadeau, Jean-François, L'Église a joué un rôle dans la disparition du français en Louisiane, Le Devoir, 22 mars 2018
[9] Nadeau, Jean-François, L'Église a joué un rôle dans la disparition du français en Louisiane, Le Devoir, 22 mars 2018
© Bastien Guérard, 2021
Les Anglais, maîtres de l’Amérique du Nord, s’attaquent à la base de la culture francophone, l’enseignement en français. La guerre contre les écoles françaises au Canada, comme aux États-Unis, vise à imposer par l’éducation, la culture anglophone en Amérique. Avec des variantes d’une région à l’autre, les gouvernements anglophones s’acharnent à détruire tout ce qui est francophone sur l’ensemble du continent.
Province d’avant-garde pour l’effacement du français en Amérique, la Nouvelle-Écosse, pays d’origine des Acadiens, abolit les écoles françaises en 1864. Elle est la seule province à le faire avant son entrée dans la Confédération canadienne. La Confédération de 1867 donne le ton aux autres provinces anglaises du Canada. Dès 1871, le Nouveau-Brunswick adopte la loi King supprimant l’enseignement en français. Toutefois, les libertés britanniques font preuve de magnanimité : « Les parents acadiens peuvent, s’ils le veulent, financer eux-mêmes les écoles de leurs enfants, tout en continuant à payer la taxe provinciale à l’éducation. »[1] Les Acadiens doivent payer en priorité l’éducation de ceux qui les oppriment et qui les maintiennent dans la pauvreté par des lois injustes. Ils doivent payer deux fois pour l’éducation de leurs enfants : après avoir payé les impôts pour l’éducation des envahisseurs anglophones, les Acadiens doivent s’organiser eux-mêmes pour leur éducation en français.
En 1877, l’Île-du-Prince-Édouard par le Public School Act supprime les écoles françaises de la province privant un autre groupe d’Acadiens de l’enseignement dans leur langue. Les Territoires du Nord-Ouest, en 1892, procèdent à l’élimination des écoles françaises et à la suppression du droit de se défendre en français devant les tribunaux. La même année, l’Alberta déclare l’anglais comme seule langue officielle des débats parlementaires et de l’enseignement, « malgré la signature d’un engagement lors de la création de la province avec Louis Riel. »[2]En 1902, la Saskatchewan interdit l’utilisation de la langue française à l’école.
En Ontario, la présence française remonte à l’époque d’Étienne Brûlé au début de la Nouvelle-France. La première école de l’histoire de cette province, fondée en 1786, était française. Elle se situait dans l’actuel quartier Sandwich à Windsor.[3] En 1912, après plus de 300 ans d’histoire francophone et 125 ans après cette première école française, l’Ontario passe le règlement 17 interdisant l’enseignement en français.
En Colombie-Britannique, bien que l’école publique soit mise en place en 1871, les francophones n’auront accès au système public qu’en 1977, plus de 100 ans après sa création.[4] Pourtant la première école de la province fut francophone.
En 1858, quatre sœurs de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne fondent à Victoria l’Académie Sainte-Anne qui jusqu’en 1973 enseigna aux jeunes filles. Dès son ouverture, la demande d’enseignement en anglais va détourner peu à peu l’Académie de l’enseignement aux francophones. Très renommée, l’Académie accueille des élèves de l’Oregon, de l’Alaska, du Mexique, du Chile et même de Hong Kong : « En principe, aucune distinction de classe ou de race n’était admise. Malheureusement, à cause de la pression de parents d’élèves originaires des États-Unis, cela ne fut pas toujours le cas, ces parents exigeant des classes séparées pour les élèves à la peau noire. »[5] Vraiment disgracieux, sachant que le fondateur de la ville de Victoria était James Douglas, un métis de Jamaïque, d’un père anglais et d’une mère esclave. L’histoire de l’Académie Sainte-Anne démontre comment l’immigration anglophone de masse impose un nouveau système de valeurs ségrégationnistes partout en Amérique au détriment des valeurs francophones d’ouverture.
À la suite de la Première Guerre mondiale où les États-Unis démontrent leur puissance en France, le pays impose subtilement l’anglais comme la nouvelle langue de la diplomatie internationale. À la même époque, la langue anglaise s’impose moins subtilement dans le pays. En 1921, dans l’Ouest des États-Unis, il était interdit de parler français à l’école. Les écoliers francophones arrivant à l’école avec un handicap de langue et ne pouvant pas s’exprimer devant les autres passaient pour des simples d’esprit.[6] La langue française perçue comme la langue des faibles d’esprit tombe en disgrâce. Aujourd’hui, l’histoire oublie que de grandes institutions de savoir comme l’Université de Saint-Louis sont issues de l’Académie de Saint-Louis fondée en 1818 par des jésuites francophones.[7]
La Louisiane modifie sa constitution en 1921 pour rendre obligatoire l’enseignement public en anglais. Cet état impose l’anglais à des milliers d’enfants d’âge scolaire, leur interdisant de parler la seule langue qu’ils connaissent. Pour avoir parlé français à l’école, les enfants subissaient des punitions et de l’humiliation. Des cours d’orthophonie étaient donnés aux élèves pour faire disparaître leur accent français. En Louisiane, pourtant fondée par des francophones, le français est considéré comme une langue inférieure, disgracieuse et un signe d’ignorance.[8]
En 1921, la nouvelle constitution de Louisiane oblige l’éducation en anglais

L’anthropologue Serge Bouchard décrit ainsi la situation du français en Amérique du Nord : « Ce qu’il convient de souligner, toutefois, c’est la nature de la maladie : déclarer une langue inférieure, sans valeur, sans profondeur, sans histoire, sans avenir, déclarer une langue laide et dure à l’oreille, souhaiter son silence, voilà une tare historique. L’auteur de l’abus est méprisable, bien sûr, tandis que le locuteur sous attaque est forcément mis à rude épreuve. S’il se met à douter de sa langue, s’il finit par la dénigrer aussi, de gré, mais plus généralement de force, alors son amour de lui-même est perdu. »[9]
Malgré tout, il subsiste des francophones irréductibles. Dans la ville de La Vieille Mine au Missouri, un groupe de personnes tentent de perpétuer leur culture, cette culture broyée par l’hégémonie anglophone. En Ontario, le règlement 17 sera aboli en 1927, grâce à la détermination des Franco-Ontariens. Il n’en demeure pas moins que les services aux Franco-Ontariens font pitié en comparaison à ceux offerts à la minorité anglophone du Québec. Actuellement, pour la même population, les Franco-ontariens cherchent toujours à obtenir une université francophone. Au Québec, les Anglo-Québécois disposent de 3 universités.
Au Québec, le système d’éducation est formé d’une branche catholique francophone et d’une branche protestante anglophone. À l’origine, un ministère l'Instruction publique fut créé en 1868 au Québec, mais il fut aboli en 1875 sous les pressions de l'Église catholique, qui voulait contrôler l'éducation francophone dans la province. [10] Les non-catholiques, comme les Juifs, fréquenteront l’école protestante, ce qui aux yeux de l’Église catholique préserve la pureté de la race. La Révolution Tranquille des années 1960 libère le Québec francophone de l’éducation religieuse catholique et monarchiste.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’arrivée de migrants catholiques voulant une éducation en anglais pousse le Québec à légiférer pour maintenir son poids démographique face à l’immigration internationale. En 1977, le Québec adopte la loi 101 confirmant le français comme la seule langue officielle du Québec. Cette loi prévoit principalement l’affichage commercial en français, le droit de travailler en français dans les entreprises de plus de 50 employés et, pour les nouveaux arrivants, un accès à l’éducation publique en français seulement. Les anglophones préservent un droit héréditaire à l’éducation en anglais.
La loi 101 fit scandale dans le Canada anglais et fut contestée en Cour suprême du Canada qui rendit des jugements en sa défaveur en 1979, 1984 et 1986. Des Anglais iront jusqu’aux Nations Unies pour dénoncer le mauvais traitement que leur afflige la vilaine majorité francophone du Québec, baignant dans une anglophobie maladive en interdisant l’affichage en anglais.
Malgré la loi 101, le français comme langue d’usage au Canada passe de 25,7 % en 1971 à 20,5 % en 2016.[11] Malgré la tempête, les Québécois demeurent fiers de leur loi, car avec le temps les perspectives changent : « L’avocat Julius Grey, qui a contesté la loi 101 devant les Nations unies, trouve qu’il s’agit d’une mesure qui a transformé le Québec pour le mieux. »[12]
Au cours de l’histoire de l’Amérique du Nord, les idées francophones sont souvent reprises par les anglophones du continent : « Trente États américains ont légiféré pour imposer la priorité de l’anglais sur leur territoire. La Californie a même adopté une loi semblable à la loi 101 pour protéger l’anglais contre l’espagnol. »[13]
Le Canada d’aujourd’hui a beau dire qu’il a deux peuples fondateurs, qu’il est un pays bilingue, il demeure qu’aux yeux de bien des anglophones, le Canada sera un pays bilingue que lorsque tous les francophones parleront anglais : Ottawa, capitale de ce pays soi-disant bilingue, a le statut d’une ville unilingue anglaise d’Ontario.
La guerre contre les écoles françaises en Amérique du Nord vise à imposer la culture anglaise d’Amérique. « Les rêves des Indiens, ceux des Métis, ceux des Canadiens français catholiques, sont tous battus en brèche par le rouleau compresseur de la majorité anglophone qui n’a cure de cette diversité culturelle. »[14] Cette culture métissée portée par les francophones à travers le continent subit les assauts de la communauté anglophone depuis l’aube de la colonisation.
À l’origine, la colonisation française a pour objectif le commerce de la fourrure, ainsi elle cherche à s’harmoniser avec l’environnement en Amérique. À saveur plus religieuse, la colonisation anglaise voyait l’Amérique comme une Terre promise, aussi elle planifie le contrôle de l’environnement pour son expansion. Les francophones d’Amérique démontrent toujours qu’un autre monde est possible dans le Nouveau Monde. Son exploitation de l’eau d’érable reflète bien cette société recherchant l’harmonie avec son environnement.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p183
[2] https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/leffacement-progressif-du-francais-au-canada-c5924d86754949819abb4ea1de313373
[3] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/809878/premiere-ecole-ontario-francophones-windsor-anniversaire-230ans
[4] https://www.csf.bc.ca/csf/historique/
[5] http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-52/Académie_Sainte-Anne_de_Victoria_(Colombie-Britannique).html#.Xp7YSC0lCYM
[6] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[7] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p217
[8] https://www.youtube.com/watch?v=B2CXILWZLV4&feature=youtu.be en ligne 20 janvier 2021
[9] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf
[10] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-leducation
[11] https://ssjb.com/le-canada-150-ans-de-lois-contre-le-francais/
[12] https://www.journaldemontreal.com/2017/08/26/un-affichage-francais-qui-stagne
[13] https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/les-questions-de-bernier-sur-la-loi-101-994bc102d4fb628d4da1cd42e76d3ecf
[14] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p406
© Bastien Guérard, 2021
En Amérique, dans ce monde nouveau en construction, la majorité des Canadiens d’origine se trouve sous la domination de la Couronne anglaise. Principalement constitué de fermiers vivant de leur terre pour nourrir une famille nombreuse, ce peuple de défricheurs s’épanouit plus en harmonie avec son environnement que son capital : son usage du sucre d’érable en témoigne. Quelques marchands et notables francophones alimentent l’économie de la communauté francophone, mais ils ont moins accès au grand capital contrôlé par une élite anglaise. À la fin du XIXesiècle, la traite de la fourrure devient marginale, l’économie ne passe plus par les chemins qui marchent, mais par les chemins de fer. Le progrès passe par le développement technologique dépendant du capital sous contrôle des anglophones : « Pour la majorité francophone du Québec, la révolution industrielle est vécue comme un déclassement. »[1] Les Francophones étant ainsi déclassés, les Anglais imposent leur idéal de progrès grâce à la puissance du capital. Grâce à d’habiles manœuvres politiques, ils ont réussi à s’attribuer l’exclusivité de ce capital.
Le modèle d’entreprise par actions créé en Hollande pour enrichir un ensemble de personnes libres a été altéré par les Lords anglais pour devenir le capitalisme d’aujourd’hui. En utilisant leur richesse foncière pour prendre le contrôle d’entreprise et leur pouvoir à la Chambre des Lords, ils ont su orienter les politiques de l’Angleterre en faveur de leur capital. Dans une entreprise par actions, lorsqu’un investisseur contrôle à lui seul la majorité des actions, ou un seul bloc d’actions, la multitude de petits investisseurs n’a aucun contrôle sur les orientations de l’entreprise.
La Compagnie de la Baie d’Hudson, fondée par Radisson et des Groseilliers, représente bien cette dynamique économique où l’élite prend légalement contrôle d’une entreprise par la puissance de son capital. Les initiatives originales d’entrepreneurs lucides et bienveillants, comme l’installation de postes de traite dans la Baie d’Hudson, sont récupérées par les grandes fortunes tenant les ficelles du financement des projets prometteurs. Lors du traité d’Utrecht, la politique de l’Angleterre s’est confondue avec les intérêts de l’entreprise en réclamant le territoire de la Baie d’Hudson.
À la solde de quelques oligarques, les dirigeants d’entreprise influencent les politiques gouvernementales sous prétexte de servir l’économie du pays, tout en s’assurant de politiques fiscales favorables à la concentration du capital, source du pouvoir. La Révolution américaine fut contre cette concentration du pouvoir économique par la noblesse anglaise.
Montréal - Pont Victoria – Lien permanent pour le chemin de fer dès 1860

Contrairement à la Révolution française, la Révolution américaine ne fut pas laïque : même si elle a libéré le capital du contrôle des Lords d’Angleterre, le peuple demeure soumis aux doctrines religieuses justifiant l’injustice sociale. En Angleterre, comme aux États-Unis, l’organisation sociale a été structurée par des lois favorisant l’élite en créant un système pyramidal d’accumulation de capital. La Révolution américaine a servi à libérer le grand capital d’un héritage monarchique pour en faire un héritage familial.
Depuis l’ère industrielle, la concentration du capital favorise le développement technologique; ceci soutient une plus grande accumulation de capitaux grâce à une exploitation plus raffinée des ressources. Aujourd’hui, le grand capital est sous l’emprise de personnes morales immortelles maximisant la rentabilisation de son environnement terrestre. Et c’est ainsi que se maintient la fiction d’une Destinée manifeste soutenant que l’anglophone d’Amérique est chargé d’une mission divine évidente: Dieu l’a chargé de propager ses valeurs de démocratie capitaliste aux autres nations.
Aujourd’hui, les États-Unis dominent le monde grâce à sa puissance économique développée grâce à l’exploitation abusive des ressources humaines et naturelles sur un nouveau continent. Cette conception anglo-américaine de l’organisation économique a orienté la société vers la défense du droit individuel pour protéger l’accumulation de capital, au détriment du droit collectif veillant au bien-être des citoyens et de leur environnement.
L’utilisation de technologies toujours plus avancées pour la maximisation d’un profit enregistré dans un système de capitalisation financière repose sur une fiction monétaire. L’effondrement du système financier rendrait la monnaie aussi utile aux échanges qu’un wampum amérindien l’est actuellement. Portant cette valeur monétaire qui sert au réinvestissement dans de nouvelles technologies pour stimuler la consommation et l’accumulation de capital, représente une constante fuite en avant au détriment de l’environnement humain et naturel.
Aux États-Unis, la nature généreuse et l’immigration massive ont fait oublier que la pérennité du capital repose sur un environnement sain et une humanité en santé. En Europe, la France n’avait pas l’espace et les ressources disponibles qu’offre l’Amérique du Nord pour profiter pleinement de sa Révolution. Comme dans tous les pays des vieux continents, les infrastructures du passé et le poids des traditions modèrent souvent les élans vers l’avenir. Devant la puissance industrielle américaine construite sur un continent sauvage, la France d’aujourd’hui fait pâle figure. Plus laïque, le pays est paralysé par les innombrables normes qu’engendrent les revendications sociales. Le développement à court terme peut être fulgurant, mais le long terme demande un juste équilibre entre plusieursingrédients se rapportant l’organisation des échanges, à la société et à l’environnement naturel.
Le Japon, forcé par les États-Unis à s’ouvrir au commerce international en 1867, représente une nation ayant su naviguer dans le nouvel environnement créé par l’ère industrielle. Ce pays disposant de peu de ressources, replié sur lui-même depuis l’époque des grandes découvertes, relève le défi des États-Unis avec tellement de brio que l’impérialisme japonais recevra deux bombes atomiques en reconnaissance de son succès. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a montré à nouveau sa capacité d’adaptation aux contraintes de l’environnement ; le pays ne s’impose plus au monde, mais le séduit par l’harmonie de son paysage, sa technologie et sa cuisine. À l’ombre de la Chine, un fort sentiment nationaliste anime le pays du soleil levant.
En comparaison de la France ou du Japon, à l’aube de la révolution industrielle, les États-Unis avaient la capacité de développer son propre marché intérieur par son expansion vers l’Ouest. La puissance économique engendrée par le développement technologique supporté par un capital issu de l’exploitation aveugle des ressources, a permis au modèle de liberté économique des États-Unis de s’imposer en Amérique du Nord. À la fin du XIXe siècle, le pays impose les termes des échanges commerciaux dans les Amériques, puis au XXe siècle dans le monde libre. Aujourd’hui, bien que le succès du pays repose sur une situation historique exceptionnelle facilitant l’accès aux ressources ; ce succès propose à tort un modèle idéal de liberté permettant de réaliser égoïstement son rêve en prétendant prendre sa vie en main dans un monde de plus en plus complexe. Seules les multinationales ont la capacité de pleinement s’épanouir dans ce système d’exploitation maximale des ressources à l’échelle planétaire.
La mise en place de la mondialisation actuelle fait suite à un concours de circonstances remontant l’imprimerie en série de la Bible par Gutenberg : Réformes religieuses divisant la chrétienté, prise de Constantinople par les Ottomans; découverte de l’Amérique par les Espagnols; création d’entreprises par actions en Hollande; commerce de la fourrure en Nouvelle-France; production de laine en Angleterre; arrivée des puritains en Nouvelle-Angleterre; épidémie chez les nations autochtones; conquête de l’Amérique du Nord par les Anglais, puis par l’idéologie anglo-américaine entraînant les États-Unis à dominer le monde. Depuis les Croisades contre les musulmans à la fin du Moyen-Âge, l’histoire est toujours sous l’emprise des religions monothéistes guidant divinement les populations vers la communauté d’intérêts des élites au pouvoir. Dans cette saga historique, les guerres de religion sont les pions des élites financières pour mettre en échec le partage équitable des ressources des nations en cultivant l’antagoniste entre les personnes. Le lutte contre la Mal évacue la bienveillance humaine à la source de l’humanité.
Le monde sauvage disparaît au profit d’un monde encadré par la technologie humaine. Les chemins qui marchent entretenus annuellement par la Nature tombe dans l’oubli, tout comme la Nature elle-même. Au nom du bien de l’humanité, le canot disparaît au profil de moyen de transport plus efficace. Des moyens de transport efficaces conduisant à la surexploitation de la Nature avec le développement technologique, car la dynamique du système ne vise que l’accumulation de capitaux. L’esprit de liberté qu’apportait le canot en communiant avec la Nature est disparu avec son usage comme moyen de transport. Contrairement au canot pouvant être réparé avec la gomme de pin ou autres matériaux à portée de main dans la nature, la concentration du capital conduit à une dépendance envers les technologies que le système propose. Des technologies nous rendant captifs d’un système d’exploitation contre nature. Les petites éoliennes servant à l’autonomie des ranchs du XIXe dans l’Ouest de l’Amérique ont disparu au profit d’immenses éoliennes pour maintenir une dépendance envers ce système d’accumulation de capital.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Bédard, Éric, Histoire du Québec pour les nuls, First édition, 2012, p163
© Bastien Guérard, 2021
Le Canada, comme les États-Unis et d’autres nations, s’est formé en excluant d’autres groupes humains; ainsi, en perpétuant un mythe fondateur, les pays nouvellement formés assurent la prospérité de leur population. Dans le Dominion britannique du Canada, la fidèle élite anglaise dispose des terres de la Couronne obtenant ainsi les ressources nécessaires à sa rapide expansion économique. La protection des terres autochtones par la Couronne britannique fera des Amérindiens les premières victimes de la mise en place d’un nouveau système socio-économique prédateur trouvant ses racines dans la monarchie anglaise et la religion chrétienne. Au Québec, la Révolution industrielle a lieu dans ce contexte où l’élite anglaise cherche à éliminer ceux ne cadrant pas dans sa vision de la colonisation en Amérique. Les Québécois, bien que d’origines chrétiennes et européennes, cadrent mal avec cette vision, car ils sont catholiques et les descendants de colons francophones imprégnés de cultures autochtones.
La Révolution industrielle touche tous les domaines de la société québécoise : elle conduit au déclin de la traite de la fourrure, mais stimule le domaine traditionnel du sucre d’érable. Comme pour le chemin de fer, le développement de nouvelles technologies repose sur l’accès aux capitaux. Le premier évaporateur d’eau d’érable est inventé aux États-Unis en 1889. [1] Toute la nouvelle technologie pour l’exploitation de l’érable provient de ce pays en plein cœur d’une grande révolution industrielle. Vers 1870, les sceaux en fer blanc pour recueillir l’eau d’érable remplacent l’écorce de bouleau qui, depuis des temps immémoriaux, servait à la fabrication de casses pour la récolte de la sève d’érable.[2]L’usage de matériaux durables, comme les sceaux en fer, pour recueillir l’eau d’érable et des outils plus performants, comme les bouilleuses, offrent de nouvelles perspectives dans la gestion des ressources. Les sucriers québécois intègrent les éléments de modernité disponible à leur mode d’exploitation de l’érable. Cette situation révèle le peu d’accès au capital par les francophones d’Amérique pour le développement de technologie industrielle favorisant une économie reposant sur les ressources locales.
La Révolution industrielle demande l’apport de capitaux pour la construction des infrastructures nécessaires au développement d’un secteur d’activité agricole ou manufacturier. L’accès aux capitaux permet à un groupe humain de déterminer l’orientation de son développement en fonction de ses intérêts. Les puissances européennes ont colonisé l’ensemble de l’Asie, à l’exception de la Thaïlande et du Japon. En conservant le contrôle de ses capitaux, le Japon a pu orienter son développement et harmoniser ses activités économiques avec l’évolution du monde, tant sous le régime impérial d’avant-guerre que sous le régime démocratique d’après-guerre. En plus de l’apport de capitaux, le soutien du gouvernement pour faciliter l’accès aux ressources pour la mise en place d’un vaste projet économique est nécessaire. Pour une nation, une série d’éléments complémentaires sont nécessaires à la réalisation de grands projets, comme la formation de la main-d’œuvre, la cohésion sociale et un sentiment d’appartenance au projet social.
Le rôle honorable d’un gouvernement national est de faciliter le développement économique afin de mieux servir son peuple à long terme. La responsabilité de l’élite envers son peuple varie d’une nation à l’autre en fonction de sa perception du sens de l’histoire. Le sentiment perçu par le peuple envers son élite varie également d’une nation à l’autre : au Japon l’élite protège les traditions lors de modernisation au début du XXe siècle, tandis qu’en URSS, pour l’élite, la modernisation passait par la création d’un nouvel humain : homo sovieticus. L’élite économique tirant les ficelles du pouvoir est toujours déchirée entre son propre intérêt et celui de justifier sa place dans l’histoire de son peuple. Un roi de droit divin a la tâche facile à cet effet. Face au pouvoir, le sentiment nationaliste est variable dans le monde. Comme nous le verrons, il en va de même au Canada.
L’année suivant l’exécution de Louis Riel, la province de Québec porte à sa tête un Premier ministre ouvertement nationaliste, Honoré Mercier. Outré par le comportement des Anglais lors de l’affaire Riel, symbole du racisme systémique des Anglais, Mercier veut faire du Québec le foyer national des Francophones d’Amérique. L’affaire Riel représente pour les Canadiens d’origine, ce que fut l’affaire Dreyfrus pour les juifs d’Europe : un réveil nationaliste en réponse à des politiques reposant sur une vision tordue de la théorie de la sélection naturelle.
Mercier veut utiliser pleinement les pouvoirs que la Constitution de 1867 octroie au Québec. Dans cette optique, en 1887, un an après avoir accédé au pouvoir, il convoque la première conférence des Premiers ministres provinciaux à Québec. Seulement vingt ans après la formation du pays, le clivage entre l’intérêt économique des provinces au service de petites entreprises familiales et la volonté centralisatrice du gouvernement fédéral au service des grandes corporations apparaît déjà.
Pour le Québec, Mercier a de grands projets de modernisation en agriculture et en éducation. La construction de chemins de fer, de routes, de ponts, de même que le développement de l’industrie laitière demande des capitaux. Pour financer ces projets, il ne se donne même pas la peine d’aller solliciter les financiers anglais de Montréal. Il va directement à New York; après des refus là-bas, il se rend à Londres, mais toujours sans succès. Mercier trouvera un financement à Paris, toutefois moindre qu’espéré, auprès du Crédit lyonnais. Les difficultés rencontrées ne sont pas fortuites comme en témoigne à l’époque le haut-commissaire du Canada à Londres : « les agents du gouvernement fédéral s’employaient à l’échec de Mercier. Leurs moyens d’action quasi infaillibles en Angleterre n’étaient pas négligeables en France. « J’ai atteint mon objectif, écrivit un peu plus tard Sir Charles Tupper, Mercier ne peut se procurer d’argent. » » [3] À l’aube du Canada, le Québec subit déjà le pouvoir de la finance internationale qui entend influencer le développement socio-économique des nations.
À la fin du XIXe siècle, la modernisation de l’agriculture libère une main-d’œuvre francophone qui vient habiter Montréal, cœur industriel du Canada. À l’époque, la ville représente 80% de la puissance industrielle du pays. Toutefois, les investissements dans le développement économique de la ville et de la province sont insuffisants pour absorber les Francophones de la campagne venant travailler dans des manufactures en ville. Mercier n’a pas obtenu les capitaux nécessaires pour stimuler un développement industriel capable d’absorber cette migration vers les villes. Le capital anglais du Canada sert au développement du pays à l’Ouest du Québec. Le manque de travail à Montréal et au Québec en général, additionné à une forte croissance démographique, entraîne plus de 1 million de Québécois vers les manufactures bien capitalisées de la Nouvelle-Angleterre.[4]
Symbole de cette époque de lutte pour préserver une communauté francophone active au Québec, Mercier nomme le légendaire Curé Labelle, sous-ministre à la colonisation. Témoin de l’exode des familles vers les États-Unis, ce dernier fait la promotion de la construction d’un chemin de fer pour le développement des Laurentides par une colonisation francophone. L’idée est de contrer l’exode annuel de milliers de Québécois vers les manufactures de Nouvelle-Angleterre. À cette fin, le Curé Labelle mènera de nombreux combats pour construire le P’tit train du Nord, en particulier contre les gens d’affaires anglais et l’élite de l’Église catholique qui s’y opposent.
Le Curé Labelle

Pour le Québécois quittant sa province, il est plus intéressant d’aller s’établir aux États-Unis et y vivre pleinement le rêve américain. Contrairement au Canada, les États-Unis disposent d’une population et de capitaux locaux suffisants pour mettre sur le marché une variété de produits manufacturés. Le pays offre davantage d’opportunités aux nouveaux entrepreneurs. Mais ce rêve de liberté a été manipulé et ne ressemble pas à celui qui était porté par les Canadiens d’origine.
À l’ère industrielle, l’économie mondiale vit l’époque du capitalisme impérialiste triomphant. Les habitants des États-Unis, qui se sont attribué le nom d’Américain, considèrent les Amériques comme leur territoire naturel. Ils développent la doctrine Monroe pour justifier leur intervention dans toutes les Amériques. Tandis qu’à la Conférence de Berlin de 1885, les puissances européennes se partagent l’Afrique. Les frontières du marché de l’entreprise manufacturière se confondent avec celles de l’Empire dans lequel elle évolue.
Le Canada rattaché à l’Empire britannique dispose d’un marché intérieur 10 fois plus petit que le marché des États-Unis. Le pays a perdu l’accès à ce vaste marché suite à la Guerre de Sécession en raison du support du Canada anglais aux sudistes. Ce qui entraîna la rupture par les États-Unis du traité de réciprocité économique entre les deux pays. Au Canada, le potentiel de débouchés pour de nouveaux produits devient plus restreint. Bien que les entreprises canadiennes aient accès au marché des États-Unis, il y a une barrière à l’entrée qui taxe la marchandise à l’avantage du développement manufacturier local. Les Canadiens doivent trouver des niches commerciales particulières pour percer le marché aux États-Unis. Dans ce contexte, l’économie canadienne s’est spécialisée dans l’approvisionnement en matières premières au détriment du développement d’une industrie pour leur transformation.
Les Francophones immigrés aux États-Unis sont exploités dans les usines de textiles de la Nouvelle-Angleterre comme tous les immigrés de première génération. Ils forment rapidement des communautés que soudent la langue française et l’Église catholique. Au début du XXe siècle, les Canadiens d’origine forment de fortes communautés dans le Nord-Est des États-Unis. À tel point qu’en 1910 c’est l’un d’eux, Aram-Jules Pothier, qui devient gouverneur de l’État du Rhode Island. [5] Il est le premier francophone à être élu à un poste aussi élevé dans la gouvernance des États-Unis. Par contre, il n’était pas le premier à s’impliquer dans la politique du nouveau pays, l’honneur revenant à : « Jean-Charles Frémont, l’explorateur et politicien américain d’origine canadienne-française qui se portera candidat républicain aux premières élections à la présidence des États-Unis. »[6] Sans surprise, Washington a gagné.
Tout au long de la construction des États-Unis, les Canadiens d’origine ont influencé le rêve américain de liberté par leur présence et par leur esprit de liberté lucide. L’immigration massive des Canadiens d’origine en Nouvelle-Angleterre, berceau de la Destinée manifeste, marquera l’ensemble des États-Unis au XXe siècle. Leur présence influence la concentration du capital par l’établissement d’une Caisse populaire Desjardins à Sainte-Marie de Manchester dans l'État du New Hampshire en 1908. Cette coopérative bancaire marque le début du mouvement des crédits unions aux États-Unis. Aujourd’hui, près de 44 % des habitants des États-Unis font usage de coopérative bancaire.[7]
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] https://ppaq.ca/fr/sirop-erable/origines/ en ligne 20 janvier 2021
[2]http://classiques.uqac.ca/contemporains/delage_denys/influence_amerindiens/influence_amerindiens_texte.html#_ftn96en ligne 20 janvier 2021
[3] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p186
[4] Boulianne, Bruno, Un rêve américain, Euréka Productions, 2013, 92min
[5] https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2000-n61-cd1043394/8565ac.pdf en ligne 27 avril 2021
[6] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p292
[7] https://fr.abcdef.wiki/wiki/Credit_unions_in_the_United_States en ligne 27 avril 2021
© Bastien Guérard, 2021
À l’arrivée de la Révolution industrielle, les Francophones du pays ne contrôlent pas les leviers économiques et politiques. De plus, ils n’ont plus accès aux connaissances fondamentales, car la bibliothèque du Parlement à Montréal contenant les collections de livres constituées par le parti Canadien et le parti Patriote est disparue en 1849. Elle fut brûlée à l’instigation des Anglais : « Une édition spéciale du journal The Gazette a jeté de l’huile sur le feu…. La bibliothèque, en particulier, constitue une cible de choix. Il se trouve là plus de 25 000 livres, de même que des documents d’archives qui datent des origines de l’Amérique coloniale. Tout part en fumée. Il s’agit d’un des autodafés les plus terribles de l’histoire des Amériques, si on garde en mémoire la destruction, en 1561, des codex mayas devant l’église de pierres grises de Valladolid. »[1] L’histoire et les connaissances accumulées par les Francophones d’Amérique sont oblitérées pour la bonne marche d’une civilisation dominatrice de son environnement au nom de Dieu. Ce n’est pas en détruisant ce qui touche une civilisation que l’on démontre la grandeur de la sienne.
Au Québec, l’exploitation de l’eau d’érable demeure une tradition d’origine autochtone bien ancrée dans la culture francophone d’Amérique. Cette tradition évoque toujours la possibilité d’une intégration civilisationnelle et d’une vie en harmonie avec son environnement. Toutefois à l’époque, la civilisation européenne s’implantant en Amérique carbure à l’obscurantisme religieux dans une perspective historique équivalant à un trou noir. En ce temps difficile, dans un esprit de défi, la Francophonie d’Amérique qui peine à survivre et à maintenir ses traditions prend pour devise Je me souviens.
Grâce à l’enseignement, la religion catholique a réussi à maintenir vivante la culture des Canadiens d’origine, même si elle en a perverti l’histoire. Il faut se souvenir que sous le couvert de la vertu, l’Église s’infiltre dans tous les aspects de la société. Même dans l’espace de liberté issue des traditions autochtones que représente la cabane à sucre.
Le dimanche des Rameaux, le sucrier se faisait un devoir de faire bénir à l’église une nouvelle branche de sapin pour remplacer, au-dessus de la bouilleuse, celle de l’année précédente.[2] Cette branche de sapin sert à arrêter le gonflement du sirop dans le chaudron pour éviter les débordements : on donne ainsi une vertu divine à une technique autochtone. L’intégration de la dévotion religieuse aux techniques démontre le rôle éducatif de la religion, mais également l’utilisation du savoir pour asseoir l’autorité de la religion en donnant une origine divine au savoir-faire.
L’accès à la connaissance est la clé de voûte de l’Église. La construction de gigantesques cathédrales pour imposer sa grandeur sur le peuple, devint le talon d’Achille de l’Église : la technologie nécessaire à la conception d’édifices majestueux concentrant tout le savoir de l’époque, constitue une banque de connaissances propice à une société plus scientifique. La science en expliquant les mystères de l’univers sur lesquelles l’Église bâtit ses convictions, va à l’encontre des croyances religieuses qui s’effrite inexorablement. L’Église gardienne de savoirs ancestraux, tout en étant à l’affût des nouveaux développements sociaux, tend à libérer l’accès à la connaissance en fonction de ses intérêts. La société sous le contrôle de l’Église évolue dans un perpétuel jeu d’équilibre entre le renforcement des croyances obscurantistes pour le maintien de son autorité et la libération du savoir pour s’adapter aux technologies de la société en évolution.
Le perfectionnement de l’imprimerie avant l’époque des Lumières provoque une première fissure dans le contrôle religieux de la connaissance. Avancée à l’époque des Lumières, l’idée d’un accès au savoir pour tous est poursuivie par de nombreux groupes, encore aux XIXe siècles. L’Institut canadien, fondé en 1844, poursuit cet objectif en offrant à ses membres l’accès à une bibliothèque disposant de livres interdits par la Congrégation de l'Index du Vatican. Ce répertoire de livres interdits par le Vatican a été créé au XVIe siècle et nourri par les congrégations religieuses, dont celle de l’Inquisition. À l’époque de la création de l’Institut canadien, les Francophones n’ont pas accès aux collections de livres ouvertes au grand public, celles-ci étant réservées aux institutions religieuses.
L’Institut canadien est considéré comme une menace pour la foi et pour l’autorité que l’Église catholique exerçait sur les Francophones. En offrant l’accès à une collection de 10 000 ouvrages et en organisant entre 1845 et 1880 plus de 650 conférences, chacune suivie en moyenne par 200 personnes,[3] les membres de l’Institut canadien représentent les irréductibles de l’idéologie des Lumières. Monseigneur Bourget, évêque de Montréal se voue à l’élimination de ce groupe de perturbateurs.
L’Institut canadien représente le dernier bastion d’un idéal de liberté lucide animant les Canadiens d’origine, car : « L’instinct de conservation qui domine maintenant le Canada français contraste avec la volonté de progrès et de liberté des années 1830 et 1840, volonté que les Anglais ont étouffée par les armes avec le soutien de l’Église. »[4]
En juillet 1869, avec l’appui du Vatican, Monseigneur Bourget prononce un interdit contre l’Institut canadien, entraînant l’excommunication de ses membres. En novembre 1869, Joseph Guibord, un imprimeur, décède sans avoir renoncé à son statut de membre de l’Institut. L’Église refuse à sa veuve de le faire enterrer dans le cimetière catholique de Côte-des-Neiges. Une saga judiciaire de 5 ans s’ensuivit, qui fut tranchée par le Conseil privé à Londres en faveur de la veuve de Guibord : la Couronne anglicane est toujours disposée à s’opposer au Vatican.
Le transfert de la sépulture du cimetière protestant au cimetière catholique de Côte-des-Neiges, pour y rejoindre son épouse décédée entre temps, ne se fit pas sans heurt : « Le 2 septembre 1875, une foule de catholiques indignés fait échouer la tentative d'enterrer le corps dans un cimetière catholique. L'inhumation a finalement lieu le 16 novembre, grâce à la présence d'une escorte militaire armée. »[5] Une dalle de béton est coulée à l’endroit de son inhumation pour éviter que le corps ne soit déterré par de fervents catholiques. L’Église va avoir le dernier mot : MonseigneurBourget désacralise le lot où Joseph Guibord est enterré.
Pamphlet contestant le déplacement de la sépulture de Joseph Guibord

Quelques années plus tard, le nouveau quartier du Plateau Mont-Royal décide de nommer une rue Guibord pour commémorer ce personnage que seule la mort rendit célèbre. Mais, par une malencontreuse erreur de transcription au plan de la ville en 1879, la rue prit le nom de Gilfort. [6] Cette histoire démontre à quel point l’Église catholique domine la culture francophone au Québec entre 1840 jusqu’en 1960. Face à la puissance de l’Église catholique, l’Institut canadien fermera ses portes en 1880.
À la fin du XIXe siècle, la religion catholique contrôle la diffusion du savoir chez les Francophones d’Amérique : « Le premier ministère de l'Instruction publique est créé en 1868 au Québec, puis aboli en 1875 devant les pressions de l'Église catholique, qui juge pouvoir seule assurer l'éducation dans la province, la seule sans ministère de l'Éducation à l'époque. »[7] Il s’agit d’un échange de bons procédés entre le colonisateur britannique et l’Église catholique, car cette dernière se voit confier des secteurs clés où, par vocation, elle peut orienter l’âme du peuple : la santé, l'éducation et les services sociaux. [8]
L’Église, à vouloir trop imposer ses croyances au détriment des connaissances, finit par rompre le lien de confiance avec la population. Au Québec, l’opinion se renverse brusquement avec la Révolution tranquille dans les années 1960 alors que l’Église catholique est évacuée de la sphère publique. Le gouvernement provincial du Québec se réapproprie l’éducation, la santé et les services sociaux qui jusqu’alors étaient sous l’emprise de l’Église catholique. Pendant plus de 120 ans, de la Rébellion des Patriotes jusqu’à la Révolution tranquille, l’Église catholique a fait du Québec son pensionnat francophone.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/593091/l-attaque en ligne 11 janvier 2021
[2] Dupont, Jean-Claude, Le temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p150
[3] https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/138188/institut-canadien-de-montreal-histoire en ligne 11 janvier 2021
[4] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p180
[5] https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/guibord-affaire en ligne 11 janvier 2021
[6] https://histoireplateau.org/toponymie/vp/gilford/gilford.html en ligne 11 janvier 2021
[7] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-leducation en ligne 11 janvier 2021
[8] https://quebec.huffingtonpost.ca/normand-rousseau/les-quebecois-l-glise-et-la-federation_a_23078436/ en ligne 11 janvier 2021
© Bastien Guérard, 2021
Cet héritage francophone d’une plus grande justice sociale provient à la fois, de façon plus ou moins claire, des valeurs autochtones et de la mission de l’Église catholique, qui est de venir en aide à son prochain. Dans les milieux catholiques de l’époque, l’Église centralisatrice fait office de service social, alors que dans les milieux protestants l’Église se limite à encourager le financement d’organismes caritatifs pour le soutien des plus démunis. L’approche protestante décentralisée laisse plus de place à des solutions diverses aux problèmes sociaux.
Plus ouverte dans ses rapports avec la Bible que la religion catholique, la religion protestante demeure tout aussi rigoriste face à l’existence possible de mondes de liberté lucide. Chez les protestants, le domaine des affaires est très vaste, mais des balises rigides ne tolèrent aucun écart aux « vraies » affaires; comme nous le verrons dans un instant, toute dérogation donne lieu à des invectives violentes.
Le missionnaire anglican, le révérend Beaver, envoyé par la Compagnie de la Baie d’Hudson à fort Vancouver dénoncera par de nombreuses lettres de protestation au siège de la compagnie à Londres, le comportement immoral et indigne de Jean-Baptiste McLoughlin en Oregon. [1] Tout comme au Québec, le monde de liberté lucide s’épanouissant dans les French Prairie de l’Oregon ne convenait pas au modèle d’affaires souhaité par l’élite protestante.
À travers le continent, des missionnaires venus de la province de Québec fondèrent des institutions d’enseignement pour éduquer les enfants des trappeurs métis. Pendant que le rouleau compresseur de l’immigration anglo-américaine donne son caractère à l’Amérique actuelle, les œuvres des missionnaires perdent leur vocation d’origine. Par exemple, l’Académie Sainte-Anne à Victoria fondée par la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne fut contrainte à l’enseignement en anglais et à exclure les Noirs après l’arrivée des colons des États-Unis.[2]
L'académie Sainte-Anne de Victoria

La culture anglaise d’Amérique prétend être l’instigatrice d’un monde ouvert, épris de liberté, qui apporta la civilisation sur le continent. Elle préfère oublier le rôle de ceux l’ayant précédée : en 1870, à Los Angeles, la seconde langue en importance est le français… après l’espagnol. [3] Le concept de la Destinée Manifeste installe une dynamique mensongère au nom du profit et de la gloire. L’élection de Trump à présidence des États-Unis illustre le summum de cette culture misogyne mensongère.
En Amérique, la culture très chrétienne de liberté prônée par l’Église place la femme à la maison au service de son mari. En 1849, l’incendie de la bibliothèque du Parlement efface la mémoire des Canadiens d’origine et celle de leur relation avec des sociétés autochtones plus matricentrées ; la même année, on applique les préceptes patriarcaux de la religion chrétienne en retirant le droit de vote aux femmes canadiennes. « Ne pas faire voter les femmes et tous ceux qui ne jouissent pas du droit de propriété, c’est l’assurance de maintenir en vigueur un cadre conservateur. »[4]
Au Québec, les femmes sont encadrées par une Église catholique omnipuissante. La pression de l’Église n’est pas étrangère à la revanche des berceaux. La forte croissance de la population francophone repose sur les femmes qui avaient le devoir religieux d’élever des familles nombreuses. Maintenus par l’Église à un niveau minimum de connaissances économiques, les Québécois perpétuent un modèle de développement agricole permettant un maximum d’autosuffisance. La cabane à sucre évoque cette espace de liberté que les Canadiens d’origine ont réussi à conserver. Un espace de liberté lucide laissant place à l’Amour, car traditionnellement : « Quand un amoureux donne un cœur de sucre, il faut faire un vœu en le croquant. »[5] La cabane à sucre demeure un lieu de liberté pour apprécier notre nature sauvage.
Les religieux ont détruit les croyances et les valeurs autochtones pour imposer les nouvelles valeurs européennes. La fondation d’école partout en Amérique symbolise ce nouvel encadrement culturel européen orientant la connaissance. Le Séminaire de Québec, fondé par Monseigneur Laval en 1660, deviendra l’Université Laval, un lieu prestigieux de transmission des connaissances. En plus de leur croyance, les religieux transmettent un certain savoir dont l’Église est le garant. L’Église encadre une vision sociale servant le pouvoir de l’élite. Ainsi, pour contrecarrer l’influence de l’Institut canadien chez les Francophones, l’Église catholique se doit de « créer le Cabinet de lecture paroissial afin d’offrir de la lecture inoffensive aux fidèles. »[6]
Au Québec, la première bibliothèque publique sera créée à Westmount en 1892, mais pour les Anglophones. À cause des pressions de l’Église catholique, il faut attendre 1917 pour avoir une bibliothèque publique pour les Francophones. Notons qu’une femme, Éva Circé-Côté joua un grand rôle dans l’établissement de cette institution dédiée à la connaissance.[7]
Ce retard dans l’accès à la connaissance entre Anglophones et Francophones a d’immenses conséquences. Les Anglophones de la métropole, moins contrôlés par l’Église, ont accès aux ouvrages de collection, comme ceux de la Montreal Mecanics Institute depuis 1829, et peuvent mieux s’épanouir dans un monde dont ils contrôlent les ficelles. Peu instruits, les Francophones entrainés vers les villes par la Révolution industrielle deviendront de la main-d’œuvre bon marché. Dans les villes, ils s’entasseront dans des taudis insalubres où ils continueront d’avoir des familles nombreuses.
En mars 1885, l’arrivée de la variole à Montréal démontre bien les conséquences néfastes de l’endoctrinement religieux au détriment du savoir. Un vaccin anti-variole existe depuis 1796. Les Anglophones de la ville se font vacciner, tandis que les Francophones refusent, influencés par l’Église qui considère ce vaccin, d’origine britannique, comme un remède de charlatan. L’abbé Filiatrault considère que « Montréal est punie en raison de la conduite insouciante de sa population au carnaval de l'année précédente; il dénonce particulièrement la promiscuité sur les toboggans. »[8] La mise en place de mesures sanitaires, comme la vaccination et l’isolement, rencontre une forte résistance allant jusqu’à des émeutes contre les agents de la santé publique. Quinze mois après l’arrivée du chauffeur de train infecté en provenance de Chicago, Montréal compte 5864 morts et 13 000 personnes défigurées par la variole. « Neuf victimes sur dix sont des Canadiens français, la plupart des enfants. »[9] Avant la déclaration de l’éradication de la variole par l’Organisation mondiale de la santé en 1979, « l'épidémie de variole de Montréal est la dernière apparition non maîtrisée du fléau dans une ville moderne. »[10]
Au XIXe siècle, la culture de la connaissance est beaucoup plus présente chez les Anglophones que chez les Francophones. Les Francophones ont développé une culture de la survivance sur leur ferme. De nombreux enfants garantissent une main-d’œuvre pour la ferme, l’éducation se fait sur la terre. L’enseignement, marginalisé par l’Église catholique, sert surtout à la lecture du Petit catéchisme et a compté la dîme.
Pour l’Église catholique, l’enrichissement personnel est associé au péché, tandis que l’Église protestante, créée en réaction à l’enrichissement du Vatican, encourage l’enrichissement personnel. Le protestant gagne son ciel en donnant aux œuvres de charité chrétienne, le catholique gagne son ciel en faisant preuve d’humilité devant l’ordre divin venant de Rome.
Le catholique est conditionné à accepter son sort, plutôt qu’à développer son potentiel par l’acquisition de connaissances : « Les Canadiens français du Québec et des autres provinces accordent en règle générale moins d’importance à l’éducation formelle. Même s’ils commencent à pratiquer la contraception au milieu du XIXe siècle, cette pratique est beaucoup moins répandue chez eux que dans tous les autres groupes. »[11] Le potentiel de développement économique d’une population québécoise en forte croissance est handicapé par son faible niveau de scolarisation et l’embargo des capitaux par l’élite anglaise. Cette paralysie sociale pousse de nombreuses familles à l’exil pour trouver du travail et de meilleures conditions de vie. La revanche des berceaux, comme plusieurs se plaisent à le dire au sujet de la grande fécondité des Québécoises, a conduit plusieurs Francophones sur les routes de l’Amérique.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p294
[2] http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-52/Académie_Sainte-Anne_de_Victoria_(Colombie-Britannique).html#.Xp7YSC0lCYM en ligne 28 janvier 2021
[3] https://france-amerique.com/fr/frenchtown-the-forgotten-history-of-los-angeles-french-community/?fbclid=IwAR23ReGhI3TpVMmihFvus1nhzSt1g2O7Pjx_GX3BjJG7XDpiJoxuOoNRNRU en ligne 25 janvier 2021
[4] https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/593091/l-attaque en ligne 11 janvier 2021
[5] Dupont, Jean-Claude, Le temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p134
[6] https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/143575/histoire-litterature-livres-francais en ligne 28 janvier 2021
[7] https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/144785/bibliotheques-montreal-education en ligne 28 janvier 2021
[8] https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/un-fleau-frappe-montreal en ligne 28 janvier 2021
[9] https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/un-fleau-frappe-montreal en ligne 28 janvier 2021
[10] https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/un-fleau-frappe-montreal en ligne 28 janvier 2021
[11] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-de-leducation en ligne 28 janvier 2021
© Bastien Guérard, 2022
Le rêve représente le triomphe de l’imagination : porteur de liberté, il éclaire nos nuits les plus sombres. Il est influencé par notre vécu, par notre perception du monde, par les connaissances qui nous sont transmises. Le rêve représente l’interprétation de notre relation au monde qui nous entoure. Le rêve, cette porte vers l’avenir, prend forme dans notre conscience, se transmet par la parole et perdure dans l’écriture.
Les grands rêves porteurs de l’humanité prennent racine dans l’Antiquité où l’humain prend la mesure de son organisation sociale complexe. L’imprimerie permit aux livres d’exprimer la complexité du monde dans une perspective plus vaste, puis les journaux permirent de manière quotidienne de maintenir contact avec le milieu qui nous entoure; aujourd’hui les réseaux sociaux le font instantanément. À travers ce cheminement, la profondeur de la perspective s’est perdue au détriment du sensationnalisme et du populisme.
En fonction du niveau de liberté de presse, les divers idéaux peuvent s’exprimer en vendant leur rêve à la société grâce aux journaux. Ces derniers reflètent les idéaux et les aspirations des citoyens. L’idée de base de la presse libre veut que les journaux, en devenant populaires, incitent la population à prendre les moyens pour atteindre un objectif souhaité. Toutefois, ce rêve se confronte à la réalité d’un terrain où des intérêts particuliers étaient en jeu bien avant l’arrivée de l’imprimerie.
Depuis leur apparition, les journaux influencent les courants sociaux. Les propriétaires de ces médias d’information sélectionnent les journalistes qui reflèteront le mieux leur pensée et l’orientation sociale souhaitée. Dans les sociétés dites libres et démocratiques, bien que toute sorte de publications soient admises en kiosque, les grands journaux influents appartiennent à des personnes en lien avec l’élite financière. Tout le montage financier pour le fonctionnement des médias d’information est en relation avec la publicité des entreprises qu’ils font paraître sur le support médiatique, qu’ils soient écrits ou visuels. À ce montage financier, souvent s’ajoute une information journalistique complaisante envers les publicitaires.
Presse rotative de Marinoni, 1883

CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10710
À la faveur d’une société de la consommation, les journaux d’Amérique vendent un rêve de la liberté. Contrairement aux pays totalitaires où les médias sont contrôlés par l’État pour vendre un idéal social, les citoyens en Occident ont une relative confiance envers les médias dans ce monde libre. Toutefois, cela ne veut pas dire que les gens dans les pays totalitaires soient moins bien informés ; en voyage en URSS en 1987, j’ai été agréablement surpris par le niveau d’information, de connaissances et de culture générale de la population.
En URSS, parce que le marxisme était devenu l’opium du peuple, les gens, ne faisant plus confiance au régime, ont appris à lire les journaux entre les lignes. En Occident, dans ce monde de liberté démocratique, les gens sont plus enclins à faire confiance aux journaux. Les journaux, jouissant d’une plus grande confiance en raison de la liberté de presse, manipulent plus facilement les gens. Ceci est particulièrement vrai à l’occasion de la mise en lumière de scandales par des journaux prétendant défendre une cause religieuse ou une autre cause vertueuse. Les journaux se scandalisent de la corruption des uns ou des comportements sociaux inappropriés des autres pour faire avancer l’agenda de leurs supporteurs.
En 1987, à l’occasion de mon voyage en URSS, à Leningrad, j’ai célébré le départ d’un jeune russe pour son service militaire avec ses amis. Sachant que le jeune russe se retrouverait en Afghanistan que le pays occupait à l’époque, l’un des amis me glisse à l’oreille : si le Canada était en guerre en Afghanistan, cela ne durerait pas deux ans, car avec la liberté de presse, les gens auraient vite compris que l’on ne peut imposer un système social à un peuple. Une belle illusion du monde libre, car l’URSS est demeurée 10 ans en Afghanistan[1] tandis que le Canada est demeuré 13 ans dans ce pays.[2]
Dans le monde, la liberté de presse est toujours à géométrie variable et l’autocensure devient une règle de survie pour plusieurs journalistes. À l’inverse, la confiance envers le régime politico-religieux influence la lecture que les gens font des journaux. Dans le Québec catholique, plusieurs Québécois lisaient les journaux catholiques entre les lignes étant conscients de l’influence de l’Église sur leur liberté. Les Protestants, quant à eux, n’étaient pas aussi méfiants.
À la fin du XIXe, les médias ont fait passer le colonialisme européen en Afrique sous le couvert vertueux du mouvement abolitionniste voulant mettre fin à l’esclavage. Le contexte de l’époque, baigné par la sélection naturelle et le concept de races supérieures s’y prête facilement. Jules Ferry, lors d’un débat parlementaire en France, dit ceci au sujet des races supérieures : « Parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. »[3] L’esclavage en Afrique existe depuis la nuit des temps. Le problème vient de ce que l’abolition de l’esclavage par les pays occidentaux a entraîné un surplus de captifs dans cette machine bien rodée de la traite des esclaves. Les surplus vont se déplacer vers le marché du côté oriental de l’Afrique où les Arabes font la traite négrière depuis le VIIe siècle. Poursuivant cette bienveillante mission civilisatrice, l’Europe colonise l’Afrique pour s’approprier les ressources naturelles nécessaires au succès de sa puissance industrielle.[4] Une approche philosophique semblable à celle de la Destinée manifeste issue de Nouvelle-Angleterre qui conduisit les États-Unis à la Guerre de Sécession.
Au Canada, la guerre des Boers en Afrique du Sud illustre bien la manipulation de l’information journalistique à des fins politiques. On a prétendu que la découverte d’or et de diamants dans la région du Transvaal en Afrique du Sud a influencé l’invasion de la région en 1899 : tout bon sujet britannique vous dira que ce ne sont là que des rumeurs. La couverture journalistique de la guerre des Boers enthousiasme les Britanniques de tout l’Empire. On se passionne pour les aventures d’un jeune journaliste de guerre du nom de Winston Churchill.
Les Anglais du Canada, fervents membres du prestigieux Empire britannique, s’exaltent à vouloir soutenir par tous les moyens la gloire impérialiste de leur reine Victoria. Le 1er mars 1900, à l’annonce d’une importante victoire britannique en Afrique du Sud, les Anglophones de Montréal sont en liesse. Toutefois, ils seront très offusqués par la tiédeur de ces ingrats francophones qui ne savent pas apprécier pleinement la grandeur de l’impérialisme britannique.
Les étudiants de l’Université McGill, rejoints par d’autres Anglais, défilent dans les rues de Montréal avec l’Union Jack, le drapeau de l’Empire. Cette victoire est une occasion d’aller montrer aux Francophones qui sont les maîtres : « Ils forcent les journalistes de La Patrie, sur Sainte-Catherine, à hisser le Union Jack sur l’édifice. » Ils tentent de faire de même à La Presse et à l’Hôtel de Ville, puis « les Anglo-Montréalais s’attaquent au bâtiment de l’Université Laval à Montréal, qu’ils vandalisent avant de hisser leur drapeau sur le toit. Lorsqu’un étudiant francophone a le courage d’aller l’enlever, les Anglais reprennent le saccage de l’Université en hurlant des injures racistes contre les Canadiens français. »[5] Le bâtiment de l’Université Laval, rue Saint-Denis, est le théâtre de nombreux combats ; des étudiants et ouvriers francophones du quartier accourront pour repousser les attaques des Anglais. Les troubles commencés dans la ville Montréal durent toute la nuit et s’étendront même à la ville de Québec.
Le lendemain, le Premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, télégraphie à l’archevêque de Montréal, Monseigneur Bruchési, l’enjoignant de demander aux autorités de l’Université Laval de s’excuser pour les actes de violence commis la veille, surtout parce que des « étudiants ont abattu le drapeau britannique ». Après que Monseigneur Bruchési eut expliqué que les Anglais étaient à l’origine des troubles, Laurier répond : « Heureux d’apprendre que les étudiants de Laval ne sont pas responsables. Mon information était basée sur un rapport de la Gazette de Montréal de ce matin. »[6] Laurier avait un contact fiable à Montréal pour lui donner l’heure juste, ce qui ne devait pas être le cas pour la majorité des lecteurs de la Gazette de Montréal.
Depuis la Conquête, les écrits de la Gazette de Montréal informent la planète de ce qui se passe au Québec. Lors de l’élection démocratique du parti Québécois en 1976, mes parents en voyage à l’étranger s’étaient fait offrir le refuge, le temps que les troubles sociaux se calment au Québec. Dans cette mondialisation anglophile, le journal The Gazette devient la référence internationale de ce qui se passe dans la province de Québec. Le plus vieux journal du pays, publié dans la langue de la majorité, apparaît crédible aux étrangers. Ainsi, dans ce XXe siècle marqué par l’immigration, le journal The Gazette devient la référence pour les journaux des minorités ethniques du Canada.
Au XXIe siècle, The Gazette conserve toujours la même orientation éditorialiste malveillante envers les Québécois francophones avec des titres accrocheurs comme Number of anti-Semitic incidents on the rise in Quebec (Augmentation du nombre d'incidents antisémites au Québec). En lisant cet article paru en 2020, nous découvrons que le nombre d’incidents antisémites a augmenté de 12,3 % au Québec à la suite de frictions occasionnées par la nouvelle loi sur la laïcité de l’État. Pourtant, dans le même article, on indique une augmentation de 62,8 % des incidents antisémites en Ontario où aucune loi sur la laïcité ne fut promulguée. [7] Cette province anglophone qui est le moteur socio-économique du pays oriente sa destinée ; mais le journal The Gazette s’emploie à discréditer les Francophones en pointant le Québec pour tout problème de racisme au Canada. Pour The Gazette, la récente loi sur la laïcité de l’État au Québec représente un plus gros problème que l’antisémitisme, car pour les Anglophones contrer la laïcité prime sur le racisme. Tout est relatif, disait si bien Einstein.
Ces anecdotes illustrent bien que l’ère de la société de l’information que voit naître le XXe siècle sera celle d’une désinformation au service de causes servant les intérêts de puissantes élites financières. Les spécialistes de la manipulation de l’information ne se sont jamais inquiétés de la liberté de presse et ni du droit de vote pour l’ensemble de la population. Pour plusieurs, l’enseignement sert à apprendre à lire pour pouvoir suivre les instructions et à compter pour bien les appliquer. Le sens critique ne fait pas partie des formations générales. Sans sens critique, l’histoire peut s’écrire librement et faussement par les vainqueurs en fonction de mensonges convenant à leur plus grande gloire. Le Rêve américain de liberté domine la culture de la consommation mondiale. Nos rêves sont manipulés par le système économico-culturel surgi de l’Amérique anglophone.
Ce blogue libre d’accès s’inspire de l’esprit du don autochtone.
L’esprit du don repose sur la réciprocité des échanges en fonction de la capacité des gens à reconnaître la bienveillance d’autrui envers eux.
Un système de redistribution de la richesse basé sur les talents de chacun.
Vous pouvez passer à la boutique virtuelle pour promouvoir l’esprit des Francophones d’Amérique ou faire un don.
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(1979-1989) en ligne 11 février 2021
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4le_du_Canada_en_Afghanistan en ligne 11 février 2021
[3] Beynaert, François, La colonisation au nom de l’abolition, L’Obs, no 2907, 16 au 22 juillet 2020, p31
[4] Beynaert, François, La colonisation au nom de l’abolition, L’Obs, no 2907, 16 au 22 juillet 2020, p31
[5] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p198
[6] Lester, Norman, Le livre noir du Canada anglais, Les intouchables, 2001 p199
[7] https://montrealgazette.com/news/local-news/number-of-antisemitic-incidents-on-the-rise-in-quebec/
© Bastien Guérard, 2022
